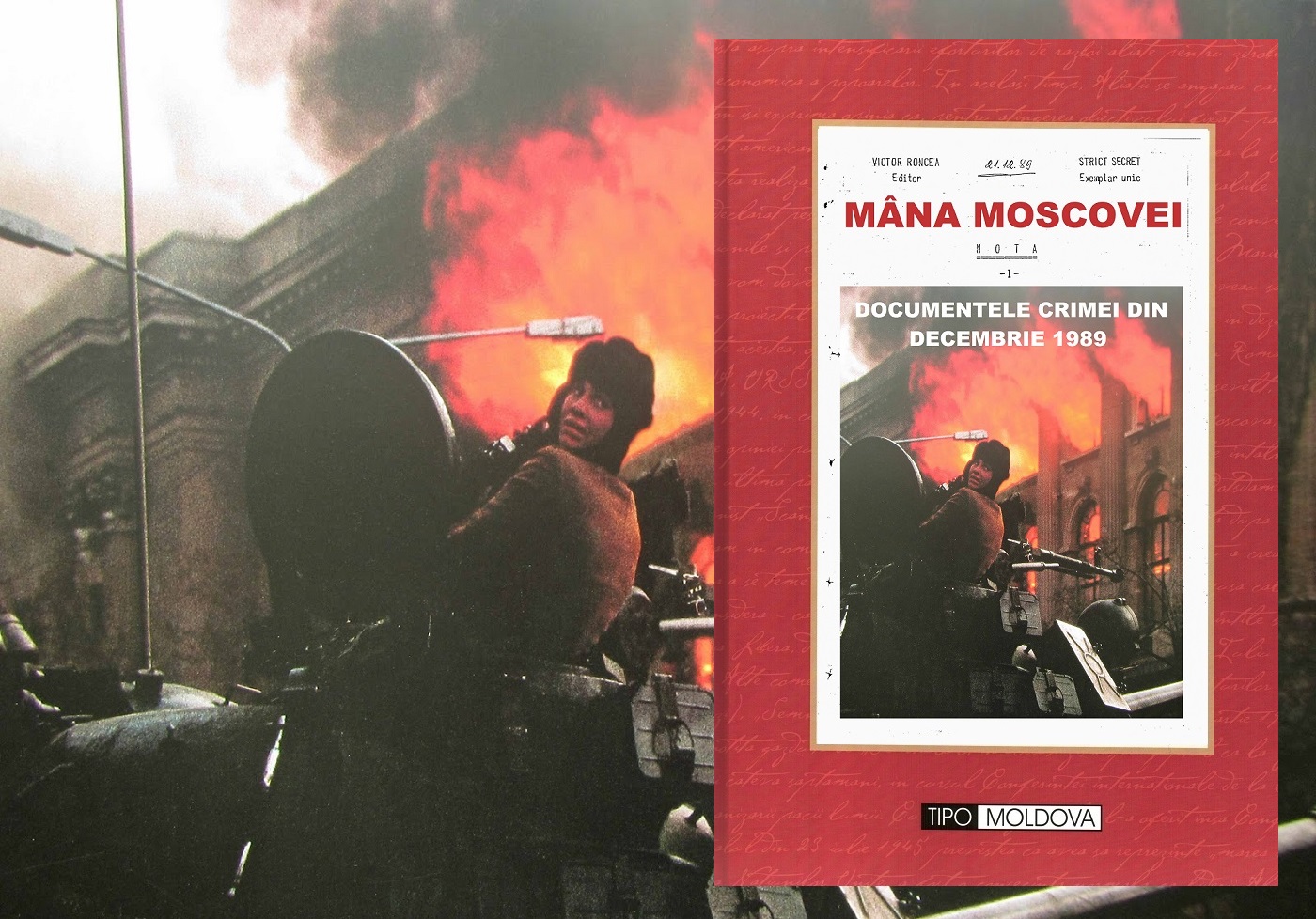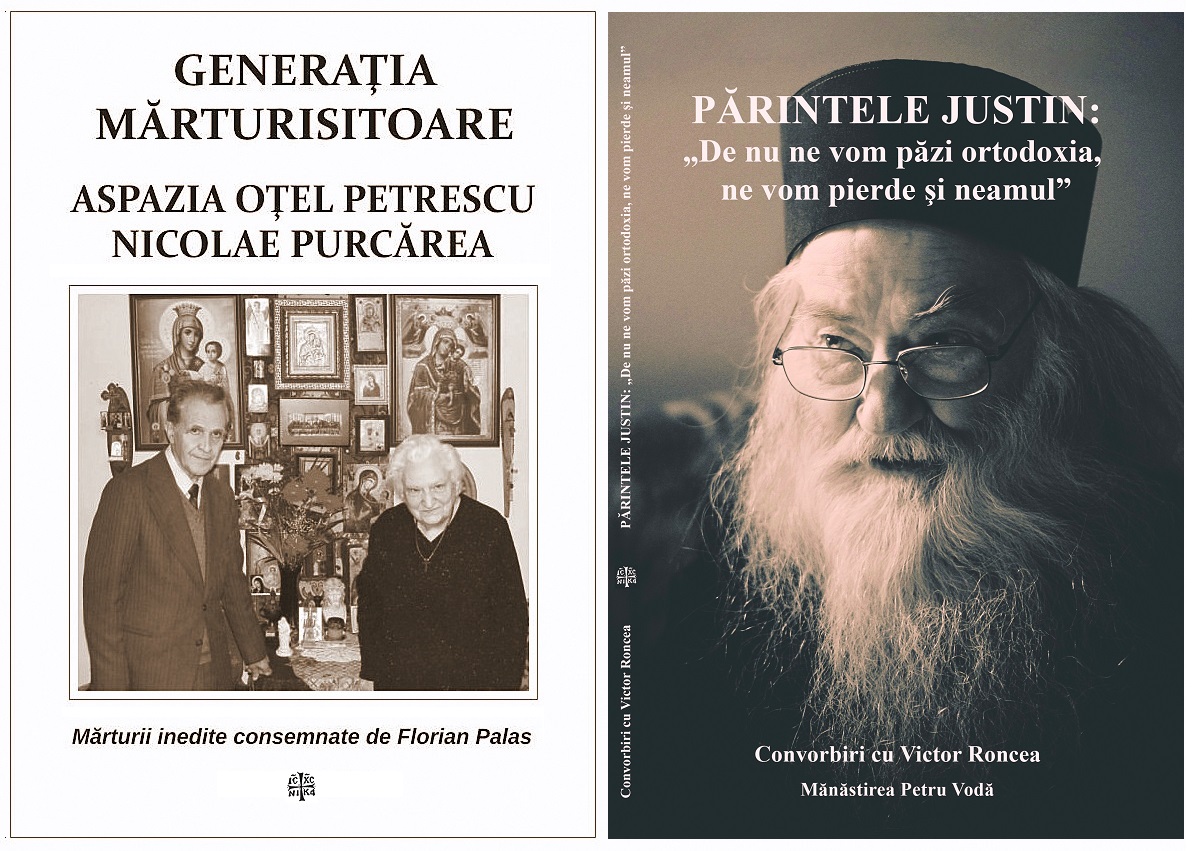Un studiu francez despre Legiunea Arhanghelului Mihail, miscare fondata in urma cu 85 de ani, la 24 iunie 1927, studiu cuprins si in lucrarea Documente din Arhiva Corneliu Zelea Codreanu, Vol V.
Un studiu francez despre Legiunea Arhanghelului Mihail, miscare fondata in urma cu 85 de ani, la 24 iunie 1927, studiu cuprins si in lucrarea Documente din Arhiva Corneliu Zelea Codreanu, Vol V.
Codreanu
Dérives, enseignements et jugements sur le mouvement légionnaire de Cornéliu Zéléa Codréanu
On a beaucoup glosé sur le mouvement légionnaire de Cornéliu Zéléa Codréanu. Pour certains, il s’agissait d’un mouvement chrétien, typiquement réactionnaire et antisémite. Pour d’autres, la réalité est beaucoup plus complexe et mérite un approfondissement doctrinal. Analyse d’un mouvement traditionaliste européen.
[Ci-contre : icône légionnaire célébrant la naissance de Codreanu, le 13 septembre 1899, sous la protection de l’Archange Michel, dont il fera le saint patron de son mouvement politique]
Il faut remonter jusqu’en 1859, si on veut comprendre avec exactitude le phénomène légionnariste et par la suite gardiste. Cette année-là est marquée par la fondation de l’État unitaire roumain qui naît de l’association des principautés de Valachie et de Moldavie.
À cette époque, la vie politique du pays se répartit en 3 collèges électoraux qui représentent les principales strates sociales existantes : les grands propriétaires fonciers, les fonctionnaires et les bourgeois des villes, les paysans. Cette répartition quelque peu injuste permet aux forces financières du pays de s’emparer de l’appareil d’État, alors même que les paysans, majoritaires, ne sont que très faiblement représentés à la Chambre des Députés et pas du tout au Sénat. Devant ce scandale, les paysans ne tardent guère à manifester leur mécontentement.
Contre l’usure
C’est ainsi qu’en 1907, les paysans roumains créent une petite révolution en s’attaquant aux riches propriétaires fonciers. À cette époque, les Juifs qui résident en Roumanie détiennent une part considérable du pouvoir financier. L’antisémitisme devient alors très virulent. Pendant cette révolte, un jeune sous-lieutenant, du nom de Ion Antonescu, futur Conducator de Roumanie, se fait remarquer par sa violence à l’égard des grands spéculateurs capitalistes. Ces événements terminés, les intellectuels comprennent la nécessité de faire participer les masses paysannes à la vie économique et sociale de la nation. En 1910, est fondé le Partidul Nationalist-Democrat (Parti National-Démocrate) avec, à sa tête, l’historien Nicolas Iorga (1871-1940) et le juriste de souche allemande Cuza. Ce parti suscite d’ailleurs l’éclosion de toute une série d’autres mouvements nationalistes.
La Légion de l’Archange Michel
Au début des années 20, la pauvreté atteint son paroxysme. Le nationalisme gagne la jeunesse. Le 24 juin 1927 a lieu la fondation du mouvement légionnaire sous le nom de la Légion de l’Archange Michel. Cinq personnes sont à l’origine de cette création : Ioan I. Moţa [orthographié parfois Motza en fr.], Ilie Gârneaţă, Cornéliu Georgesco, Radu Mironovici et bien sûr Cornéliu Codréanu.
Né le 13 septembre 1899, Cornéliu Zéléa Codréanu fait ses études secondaires dans un collège militaire. Très tôt, il prend conscience de la nécessité d’un engagement politique total sans aucune concession face au monde moderne. En octobre 1919, alors qu’il n’a que 20 ans, il adhère au mouvement patriotique de la Garde de la conscience nationale [organisation anticommuniste de masse prônant un socialisme nationaliste chrétien, créée en 1919] dirigé par l’ouvrier-typographe Constantin Pancu. Il y milite pendant 4 ans. Puis le 4 mars 1923 se constitue la Ligue de la défense nationale chrétienne [L.A.N.C. = Liga Apărării Naţional Creştine] sous la présidence de celui dont nous avons parlé un peu plus haut : le Drumont roumain, A.C. Cuza. Codréanu s’y occupe de l’organisation dans tous le pays. Il entreprend, avec quelques-uns de ses camarades de combat, la liquidation des politiciens corrompus les plus connus afin de créer un climat général d’extrême tension qui doit servir à réaliser la future révolution nationaliste. Il se doit d’être souligné qu’à l’époque, Codréanu jouit d’un grand prestige auprès de la jeunesse universitaire. Il étonne déjà par le magnétisme qu’il exerce sur les foules. Il se marie le 4 juin 1925 avec Elenea Ilinoiü devant plus de 10.000 personnes.
La Légion de l’Archange Michel peut se définir par son rôle d’ordre politico-religieux comme un mouvement qui désire renouer avec l’héritage spirituel et traditionnel, impérial-européen. Très vite, elle se dote d’une revue bi-mensuelle : La Terre des ancêtres (Pămîntul Strămoşesc) dont le premier numéro paraît le 1er août 1927.
Le 1er octobre 1927 est fondé à Bucarest le premier nid légionnaire. La Légion de l’Archange Michel peut s’interpréter comme une milice de Dieu. Son but premier est de faire s’épanouir spirituellement les individus. Sur le rôle éminemment religieux joué par la légion, Codréanu s’explique :
« La légion est une école et une armée plutôt qu’un parti politique. Tout ce que notre race peut engendrer de plus fier, de plus pur, de plus travailleur et de plus brave, l’âme la plus belle que notre esprit puisse imaginer, voilà ce que l’école légionnaire doit produire ».
Pourtant une question épineuse se pose : peut-on limiter la spiritualité légionnaire au christianisme orthodoxe ? Selon le traditionaliste italien Claudio Mutti :
« Ce qui caractérise l’essence même du légionnarisme roumain, c’est un esprit transcendant la dimension religieuse en général, et celle du christianisme en particulier, et pour laquelle la foi des masses christianisées de Roumanie constitua le véhicule d’une spiritualité plus haute ».
Julius Evola lui-même n’écrivait-il pas, lui qui, justement, s’était intéressé de très près au mouvement légionnaire, que :
« L’idée de la présence des morts — et tout particulièrement celle des héros — aux côtés des vivants, et qui est particulièrement vive dans le mouvement légionnaire, reflète d’une façon indubitable certaines formes bien connues d’une spiritualité pré-chrétienne ».
Par ailleurs, Claudio Mutti insiste :
« La formule propitiatoire d’un rituel mithriaque cite nommément l’Archange comme l’intermédiaire au travers duquel la force immortalisante du Dieu se transmet à l’initié : en fait dans le mithraïsme, l’Archange, c’est celui qui transmet au myste l’auréole glorieuse, un intermédiaire analogue au qutb de l’ésotérisme islamique, “l’axe” au moyen duquel descend la barakah. Or, on le sait, le mithraïsme se développa sur tout le territoire de l’ancienne Roumanie, très avant la christianisation, comme l’attestent les découvertes archéologiques que l’on continue de faire aujourd’hui encore un peu partout, de la Transylvanie à la Mer Noire. On peut quasiment, dans ces conditions, tenir pour certain que l’Archange “Michel” constitue un travestissement chrétien d’une entité préexistante à la christianisation de la Dacie ».
D’autre part,
« Dans la pratique légionnaire, un autre élément revêt une signification différente de celle qu’il possède dans le christianisme : il s’agit de la prière. Pour le légionnaire, celle-ci n’est pas une simple requête présentée à la divinité, une manifestation de sentimentalisme dévotionnel, mais bien plutôt un acte rituel nécessitant qui doit agir sur les forces mystérieuses du monde invisible… La prière légionnaire est, par conséquent, une récitation rituelle à travers laquelle s’exprime un acte de puissance, et non pas seulement un acte de foi ».
Il y aurait beaucoup à dire aussi sur le “sacrifice” dans la doctrine spirituelle légionnaire. Dans son Traité sur l’histoire des religions, Mircea Eliade — membre d’un cuib gardiste — écrit en substance que l’homme légionnaire est immortel dans la mesure où par son sacrifice il régénère les forces sacrées des origines. Et pour conclure sur cette question, Mutti affirme :
« Le légionnarisme va chercher ses racines au plus profond d’une culture dans laquelle l’élément chrétien ne constitue que l’ultime strate qui s’est déposée au-dessus de toute une série d’autres âmes se combinant en un synthèse totalement originale ».
Le mouvement légionnaire commence à prendre une importance assez considérable sur le plan national. Le nombre de ses militants augmente chaque mois. Alors le 20 juin 1930, Codréanu décide de constituer au sein de la légion un mouvement, la Garde de Fer (Garda de Fier) qui a pour but de parer à un éventuel coup de force militaire soviétique.
Une doctrine politique et sociale cohérente
Dans les années qui suivent, la Garde de Fer subit des attaques de toutes parts. Sa première dissolution est prononcée le 11 janvier 1931 tandis que le gouvernement national-paysan donne l’ordre à la police d’arrêter de nombreux militants gardistes. Cette répression n’empêche en rien la progression électorale du mouvement. En effet, le 3 août 1931, aux élections partielles dans le département du Neamtz (Moldavie), les légionnaires remportent une belle victoire en récoltant plus de 11.301 voix. Codréanu est élu député.
La Garde de Fer devient alors une force politique de plus en plus incontournable. Elle développe un certain nombre d’idées fortes intéressantes, notamment à travers l’ouvrage de Codréanu Pentru legionari. Ces grandes orientations doctrinales permettent de bien cerner le corpus idéologique légionnariste : rejet du marxisme comme du libéralisme démocratique, lutte politique temporelle et revitalisation spirituelle, adoption d’un type d’idéal aristocratique s’accomplissant dans une société organique et communautaire, fidélité aux principes traditionnels élitaires qui abattront l’égalitarisme niveleur, mise en place d’une véritable justice sociale rompant définitivement avec le socialisme collectiviste et le capitalisme marchand…
Malheureusement toutes ces considérations doctrinales ne viennent pas à bout de la répression régimiste. C’est ainsi qu’en mars 1932, le gouvernement Iorga-Argetoïanu exige la deuxième dissolution de la Garde de Fer. Malgré ces problèmes, le mouvement légionnaire obtient un franc succès aux élections générales de juillet (70.000 voix et 5 sièges au Parlement).
Le 10 décembre 1933, intervient une troisième dissolution du mouvement de Codréanu. Cela fait déjà plus de 3 ans que le roi Carol II est rentré en Roumanie. Cette fois-ci, 20.000 légionnaires sont arrêtés. Quant aux morts, ils sont évalués au nombre de 16. La vengeance gardiste intervient dans la nuit du 29 au 30 décembre. Le Ministre Duca est abattu par 3 légionnaires. Le 20 mars 1935, la Garde de Fer réapparaît sous le nom de Tout pour la patrie [Totul Pentru Ţară]. La présidence est assurée par le général Gheorghe Cantacuzino-Granicerul. Le 25 octobre 1936 est créé le corps ouvrier légionnaire sous le commandement de l’ingénieur Gheorghe Clime.
La doctrine légionnaire accorde une place prépondérante aux revendications sociales. Rien ne lui est plus étranger que le capitalisme financier. Cette préoccupation des intérêts ouvriers s’explique par le rôle éminemment important que revêt le travail dans l’éthique légionnaire. La prise en compte de la motivation des forces du travail doit trouver son plein accomplissement dans le dialogue avec les forces du capital, ceci dans un souci de restauration du corporatisme d’inspiration nationale-chrétienne. Cette volonté révolutionnaire de reconstituer la communauté populaire et sociale roumaine est motivée par la nécessité impérative de supprimer la lutte des classes au profit du rassemblement de tous les atomes du corps social…
L’arrestation du Capitaine
Le 20 décembre 1937, Tout pour la patrie recueille 17 % des voix et fait entrer au Parlement 66 députés. La Garde de Fer est maintenant le troisième parti de Roumanie.
La Garde de Fer prend une signification toute particulière lorsqu’on sait qu’une partie assez importante de l’élite intellectuelle roumaine la soutient. N’est-ce pas Emil Cioran qui, sous la signature des légionnaires de Paris, écrira l’article daté du 30 novembre 1940, jour anniversaire de l’assassinat de Codréanu :
« La figure généreuse de Codréanu, créateur et organisateur du mouvement légionnaire, suprême exemple de sacrifice, s’entoure pour tous les légionnaires d’une auréole de saint et de martyr. C’est lui qui le premier de tous les Roumains, avec une sûreté d’intuition étonnamment pénétrante, a proclamé qu’il fallait retrouver l’âme de la nation roumaine, constamment mise en échec, d’abord par des siècles de servitude, et tout récemment encore, par une classe dirigeante hypocrite et criminelle. Par là même, il a expliqué sa confiance dans les vertus cachées et inaltérables de notre peuple, et il a compris que ce peuple a besoin d’être libre, nous voulons dire, d’être lui-même, et non pas ce qu’on lui disait d’être ; qu’il avait une grande soif de liberté intérieure, en voulant passer sur ses propres racines. C’est pourquoi le premier effort de Codréanu a été la création d’un homme nouveau, le seul vrai, le seul capable de donner un rythme nouveau à la vie du peuple roumain ».
D’autres intellectuels comme Mircea Eliade ou Virgil Georghiu n’hésitent pas à prendre fait et cause pour le Capitaine et son mouvement.
Le 17 avril 1938, Codréanu est arrêté. Cette nouvelle persécution est ordonnée par Armand Calinesco. Deux jours après, Codréanu est jugé pour acte d’outrage à l’adresse du Professeur N. Iorga. Le verdict tombe : ce sera une condamnation à six mois de prison.
Le 27 mai 1938, la condamnation à 6 mois de prison se transforme en une peine de dix ans de travaux forcés. Le motif : trahison en la patrie ! Ce qui ne manque pas de piment lorsqu’on sait avec quelle force Codréanu défendait son pays. Au contraire, ce qui l’avait fait agir sur une voie factieuse contre l’État bourgeois roumain, c’était son attachement à sa nation et à l’idée qu’il se faisait d’elle.
Enfin, le 29 novembre 1938 à dix heures du soir, on ouvre la cellule de Codréanu et de ses 13 camarades, on les installe dans un camion, puis on les étrangle au moyen d’une corde alors que le camion roule toujours. Alors, afin de les rendre non identifiables, on versera de l’acide sulfurique sur leurs corps martyrisés pour finalement les recouvrir de ciment et de terre.
Ce massacre perpétré par les hommes d’Armand Calinesco ne restera pas sans suite. Puisque ce dernier est exécuté par 9 légionnaires dirigés par Miti Dumitresco, le 21 septembre 1939. Le même jour est organisé un véritable carnage dans les milieux légionnaires. Un nouveau gouvernement est constitué sous la dépendance du Général Argeseanu.
L’abdication du roi Carol II survient le 6 septembre 1940 alors que Horia Sima [ci-contre] est désigné successeur de Codréanu par le fondateur du mouvement Cornéliu Georgesco. Il s’entretient avec le Général Antonesco pour la formation du nouveau Gouvernement. Mais le 21 janvier 1941, Antonesco décide de “casser” la Garde de Fer. Les meurtres se comptent par dizaines. Les principaux chefs légionnaires se réfugient en Allemagne où ils seront par la suite internés dans divers camps de concentration. Car en effet, Hitler joue la carte Antonesco.
La guerre enfin terminée, les légionnaires sont libérés et acquittés au procès de Nuremberg.
► Arnaud Guyot-Jeannin, Orientations n°13, 1991.
◘ Bibliographie en français :
- Dossier “Un mouvement chevaleresque au XXe siècle, La Garde de Fer”, Totalité n°18-19, 1984
- La Garde de Fer (Pour les légionnaires), C. Codreanu, Prométhée, Paris, 1938, réed. : Ion Mării-Belmain, Grenoble, 1972
- Idem, Le Livret du chef de nid, éd. Pămîntul Strămoşesc, Madrid, 1978
- Agathon & Vulfran Mory, Codreanu et la Garde de Fer : le dossier, Trident, 1991
- Paul Guiraud, Codréanu et la Garde de Fer, éd. du Francisme, 1940, rééd. : Trident, 1990
- Faust Brădesco, Le nid : unité de base du mouvement légionnaire, Carpatii, Madrid, 1973
- Idem, Les trois épreuves légionnaires : éléments de doctrine, Prométhée, 1972
- Idem, Antimachiavélisme légionnaire, Dacia, Rio de Janeiro, 1963
- H. Sima, Histoire du mouvement légionnaire, Dacia, 1972
- Jérôme & Jean Tharaud, L’Envoyé de l’Archange, Plon, 1939
***
♦ Documentation sur internet :
• La nation roumaine (Codreanu), • Observations sur la démocratie (Codreanu), • « La tragédie de la Garde de Fer », J. Evola, (Totalité n°18/19, p. 178-197), • Le mouvement légionnaire (G. Buzatu) • In memoriam (L. Rebatet, 1938 ; autres articles), • Les Roumains Nos Alliés ? (PJ Thomas, Sorlot, 1939), • Codreanu, l’homme de la forêt (M. Gauvain, 1939), • Essai sur le fanatisme contemporain (M. Dion, Harmattan, 2002).
Le procès Codreanu
Photo prise lors du procès de Codréanu : Le Capitaine se défend ici devant ses juges. L’accusation ne tenait pas : la condamnation du chef de la Garde de Fer relève donc d’un vulgaire règlement de compte.
◘ Analyse : Horia Cosmovici, II processo Codreanu, Ed. All’Insegna del Veltro, Parma, 1989, 199 p.
[ci-dessous huile sur toile de Borislav Prangov, 2011]
Hypocrisie, fanatisme, férocité, duplicité, grand guignol. Il y a quelques mois, la Roumanie, dirait-on, s’est efforcée de présenter au monde son pire visage ; et elle a réussi. Bien sûr, ce n’était pas une entreprise facile de dépasser les fastes de “l’âge d’or” à la Ceaucescu, le Conducator communiste qui a poussé le culte de la personnalité au comble du ridicule, tout en couvrant, par ses fastes désuets, la pénurie alimentaire, la dégradation morale, la chute des valeurs, et en créant un climat de répression et de suspicion ubiquitaire ; les médias nous ont rapporté de Roumanie des images, et des impressions, qui demeureront longtemps ancrées dans les mémoires de ceux qui ont pu visiter le pays des Daces au cours des années 80. Et puis, à partir de décembre 1989, la Roumanie bascule dans un nouveau type de chaos balkanique, parfaitement stéréotypé, encore plus incertain et imprévisible.
À cause du nouveau cours lancé par Gorbatchev, la politique extérieure de Ceaucescu, qui prétendait avoir des velléités de troisième voie et bénéficiait d’un préjugé favorable dans les milieux diplomatiques occidentaux, y compris ceux qui sont non-conformistes, n’avait plus raison d’être (à ce propos, lire les pages du récit de voyage de Piero Buscaroli, reprises aujourd’hui dans le livre intitulé Paesaggio con rovine, Camunia, Milan, 1989). La satrapie du “génie des Carpathes” comprenait, au-delà de la grandiloquence propagandiste, la punition de toute forme de dissidence et le filtrage rigoureux de toute information, camouflant du même coup les contradictions d’une société économiquement chancelante et politiquement, sous-développée.
Dès l’ouverture de la boîte de Pandore, les catastrophes se sont succédé, sous l’œil indiscret dés caméras de télévision et des envoyés spéciaux. Coup d’État téléguidé, travesti en insurrection populaire, mise en scène de massacres et de lynchages, la cascade de chiffres mensongers quant au nombre des victimes des escarmouches de la semaine de Noël, le mythe de l’omniprésente Securitate et des fantomatiques mercenaires libyens, l’ignoble procès-farce fait au tyran et à son épouse, le mystère de leur exécution, l’instauration de la nouvelle dictature d’Iliescu et de Roman, les pogroms interethniques de Tirgu Mures * et les violences perpétrées par les “gueules noires”, accourues de leurs mines pour clore le bec des opposants [en majorité des étudiants manifestant en mai-juin 1990 contre Iliescu à Bucarest, et présentés par les journaux de pouvoirs et la TV comme agents subversifs au service d’irrédentistes magyars ou de puissances étrangères ou bien comme golani (vauriens)] : bref, la classe politique roumaine a consumé en un clin d’œil le crédit qu’elle aurait pu exploiter en allant à l’encontre des émotions populaires et des espoirs nés à la Noël 1989. L’effet dû à la manipulation médiatique, à la “révolution en direct”, a été effacé par la méfiance et la rancune de l’opinion publique internationale. L’image, au départ positive, du “pays réel” roumain, s’est évanouie comme neige au soleil ; résultat : nous avons affaire à un peuple hier encore infiltré par une multitude d’indicateurs et d’opportunistes et aujourd’hui lié par l’effet du plébiscite au nouvel homme fort, au néo-communisme et à ses milices prolétariennes.
Fouiller le passé de la Roumanie
Face aux spasmes d’une situation en apparence sans issue, aux incertitudes diplomatiques des gouvernements occidentaux, à l’anachronisme déconcertant des escouades en tenues de combat et casquées, les domesticateurs de notre imaginaire — les journalistes, les opérateurs de télévision, les commentateurs — ne peuvent plus, désormais, user du répertoire habituel de scoops sur les tentations pharaoniques du clan Ceaucescu. Ils ont commencé à fouiller le passé et à rechercher dans l’histoire des premières décennies de ce siècle la clef explicative des convulsions du second après-guerre roumain. On publie de plus en plus d’interviews du roi déchu, Michel de Roumanie, on se penche sur les années folles où Bucarest se déguisait en un petit Paris et où sa bourgeoisie imaginait, à tort, qu’elle allait connaître le bien-être mais sans réaliser de miracle économique ; elle cultivait la nostalgie de temps meilleurs, passés ou à venir, se saoûlait d’effluves cosmopolites, tout en demeurant à des années-lumières de la misère populaire, présente ou juste passée ; le pays était dominé tout à la fois par le subterfuge, le ressentiment, la rhétorique, le chauvinisme et l’absence de liberté.
Les choses peuvent-elles réellement se juger de la sorte ? Y a-t-il radicale discontinuité entre la Roumanie “européenne” du début de ce siècle, décrite par les gazettes, et le pays replié sur lui-même et condamné à célébrer le culte du national-communisme forgé par Georghiu-Dej et Ceausescu, le pays tombé aujourd’hui aux mains de la fraction philo-soviétique du PCR, rebaptisé Front du Salut National ? L’observateur qui connait quelques bribes de l’histoire roumaine du XXe siècle pourra sérieusement douter qu’il y a discontinuité. Un patriotisme exaspéré, une phobie de l’encerclement et, assortis à cela, une méfiance à l’égard de tous les voisins, magyars ou slaves, et de toutes les minorités intérieures, un mépris profond pour les pratiques démocratiques, le culte des “hommes forts”, tels sont les éléments majeurs qui constituent le fil rouge unissant étroitement les gouvernants francophiles et phraseurs des années 20 aux cadres dirigeants du régime communiste. Si les méthodes de gestion du pouvoir semblent s’être radicalement modifiées au fil des années, l’élimination expéditive des opposants trop ambitieux, les conjurations de palais et les coups malpropres perpétrés par les forces de police n’ont jamais cessé d’avoir lieu à Bucarest et dans l’arrière-pays roumain.
Les notes sténographiques du procès de Codreanu
Pour en savoir davantage sur ces analogies, sur l’arrière-plan des événements récents, il m’apparaît utile de lire l’essai, dense et fouillé, de Claude Karnoouh ** (« À l’Est du nouveau : L’exemple roumain », in Krisis n°5, avril 1990). Pour comparer les événements de décembre 1989 à ceux des années 30, on lira Il Processo Codreanu, un livre qui reprend partiellement les notes sténographiques du jugement de mai 1938, où comparaissait le “Capitaine” de la Garde de Fer, accusé de trahison et condamné à une peine de prison, prétexte à son élimination définitive, survenue lors d’une fausse “tentative d’évasion”. Exactement comme dans le cas du couple Ceaucescu.
Une surprenante coïncidence a fait que le livre est paru très peu de temps avant la chute de Nicolae et Elena Ceaucescu. Le lecteur le lira donc en se référant immanquablement aux événements de décembre 1989 : un régime d’exception (avec le Roi Carol qui s’était proclamé dictateur pour « le bien du pays », en supprimant les partis et en imposant la loi martiale), un procès expéditif et mis en scène par des juges militaires que l’on fait chanter à cause de leur passé, l’organisation de la censure et de pressions sur la presse, la rédaction de lettres apocryphes, les agents doubles, les manœuvres de puissances étrangères, l’amplification médiatique d’une insurrection présumée, utilisée pour réaliser un coup d’État authentique. On pourrait encore poser bien d’autres analogies.
Bien sûr, Il processo Codreanu ne peut être considéré comme un véritable document historique, parce qu’il ne contient pas tous les documents relatifs à l’accusation : il manque les interventions du procureur et celles des juges sont réduites à leur plus simple expression. Ensuite, manque également une grande partie des dépositions des témoins. Mais le livre nous révèle une trace ; il sonde le procès, si bien que nous avons un point de référence pour juger le climat d’une époque. Le livre est une contribution à l’histoire, même s’il est franchement partisan ; il a été édité par l’un des défenseurs de Codreanu et publié clandestinement, afin de réhabiliter la figure du Capitaine, au temps des persécutions contre les légionnaires. Ce document nous permet de réécrire un épisode de l’histoire, sur lequel la critique historiographique “officielle” s’est montrée assez avare en informations, et à propos duquel elle n’a pas fait preuve du moindre équilibre (1). Aujourd’hui encore, l’affaire Codreanu demeure enfouie dans les brumes et les mystères de l’État roumain, demeure objet de passions antagonistes.
Il processo Codreanu n’est pas d’une lecture facile (pour qui n’a pas une bonne connaissance du phénomène légionnaire) ni “coulante” (parce que la prose judiciaire qu’il nous livre est fragmentée ; fragmentation aggravée par les lacunes que nous avons déjà citées). Ceci dit, ce volume, pour qui évite de lire les pages où sont consignées les escarmouches d’ordre procédurier entre les avocats, nous permet de jauger la politique roumaine. On remarquera surtout l’anomalie que constitue le rapport entre, d’une part, ce qui est imputé aux accusés et, d’autre part, la personnalité des accusateurs. Les 2 camps s’opposent durement dans le contexte judiciaire, se réclament de la légitimité et nient toute légitimité à leur adversaire, recourant à des arguments émotionnels qu’ils possèdent en commun : le patriotisme, le caractère inadmissible de la trahison, la défense de la monarchie, de la race roumaine, de l’ordre constitué, la suspicion de voir en l’autre un agent d’une puissance étrangère. L’acharnement des partis montre, sous la patine de l’inimitié, une concurrence substantielle dans la course à la conquête du consensus des mêmes strates du public.
Le langage de certains témoins surprend : tous sont extérieurs aux milieux gardistes ou lui sont hostiles, mais ont pour dénominateur commun une aversion violente à l’égard des Juifs et, plus généralement, pour tous les non Roumains ; preuve exemplaire du fait, trop souvent oublié aujourd’hui, que certains stéréotypes et certaines rancœurs étaient largement diffusés dans toute l’Europe, surtout en Europe centrale et orientale dans les premières décennies de ce siècle. Ils ne se limitaient pas aux seuls mouvements dits “fascistes”.
Un règlement de compte politique
[Ci-dessous : vignette du Sceptre d’Ottokar, 1939, p. 105]
Ensuite, de ce document, ressort, sans le moindre clair-obscur, le caractère nettement politique du jugement — qui, en réalité, n’est, ni plus ni moins, qu’un règlement de compte classique — où le chef d’une force parlementaire et d’un mouvement de masse en pleine ascension (rappelons-nous que le parti de Codreanu est issu, à ce moment-là, des cendres du mouvement légionnaire dissous, a pris le nom de Totul Pentru Ţară, soit “Tout pour la Patrie”, a enregistré un large succès au cours des dernières élections législatives de 1936 ; de surcroît, on le prévoit vainqueur des prochaines législatives, du moins si elles sont organisées dans les règles) est accusé de “trahison” pour avoir détenu au siège du parti des documents « attentant à la sécurité de l’État ». Ces documents étaient en réalité des copies d’ordres donnés aux préfets et aux intendants de police pour réprimer, empêcher ou troubler par tous les moyens l’action du parti de Codreanu, pourtant légalement garantie.
Enfin, sur le fond, on s’aperçoit, en lisant ce livre, de l’incroyable imbroglio d’intrigues dans lequel se débattait le monde politique roumain. Des espions à la solde du gouvernement avaient été infiltrés à l’intérieur du parti (et auxquels Codreanu adressa directement une circulaire interne du mouvement !). On internait les opposants dans des camps de concentration, on recourrait allègrement aux provocations et à l’intimidation, on faisait largement usage d’écrits apocryphes : telles étaient les pratiques quotidiennes et communément admises.
Redécouvrir la culture politique roumaine
C’est grâce à ce cocktail d’éléments, aussi suggestifs que terribles, que l’on peut repenser l’histoire passées et récentes de la Roumanie. Il processo Codreanu, ouvrage somme toute marginal, justifie sa réédition parce qu’il acquiert, malgré lui, une pertinence sui generis, vu les événements récents qui nous obligent, nous, observateurs occidentaux, à redécouvrir la culture politique roumaine. Évidemment, il reste beaucoup de choses à faire pour réécrire, sur un mode équilibré, le demi-siècle d’histoire récente de ce pays des Carpathes, dominé en permanence par l’arbitraire et les intrigues. Et pour réécrire correctement cette histoire, il conviendrait, bien sûr, de relire les archives laissées par les témoins engagés (du moins, celles qui ont survécu aux épurations successives). Mais dans ce jeu d’omissions voulues, de silences dictés, d’évocations répétées par les protagonistes des 2 camps, les notes sténographiques prises dans une salle de tribunal peuvent se révéler un document précieux.
► Marco Tarchi, Orientations n°13, 1991.
(1) Voir par ex. le cas de Theodor Armon, qui ne cache pas son aversion pour le mouvement légionnaire, ce qui ne l’empêche pas d’être considéré dans les milieux académiques comme le principal historien du “fascisme roumain” ; Armon écrit, dans son article intitulé « Fra tradizione e rinnovamento : Su alcuni aspetti dell’antisemitismo della Guardia di ferro » et paru dans Storia contemporanea, XI, 1, février 1980, pp. 5-28 : « que le procès intenté par les autorités roumaines sous l’impulsion du Roi Carol contre Codreanu, aboutit à la condamnation à mort de celui-ci », alors qu’en réalité, la peine infligée fut de dix ans de travaux forcés. Les textes d’Armon, bien documentés sur bon nombre d’autres aspects du mouvement légionnaire, méritent toutefois d’être lus pour acquérir un jugement équilibré sur le phénomène que ne nous donne pas la prose hagiographique des présentateurs, préfaciers et traducteurs italiens des travaux consacrés à Codreanu ou émanant du “Capitaine” lui-même. Lire également, de T. Armon, les 2 articles au titre identique, « Fascismo italiano e Guardia di Ferro », publiés tous 2 dans Storia contemporanea, III, 4, sept. 1972, pp. 505-548 ; et XX, 4, août 1989, pp. 561-598. Pour une interprétation plus équilibrée, lire le livre de Mariano Ambri, I falsi fascismi. Ungheria, Jugoslavia, Romania (1919-1945), éd. Jouvence, Roma, 1980.
◘ notes en sus :
* : Ville de Transylvanie, région à population majoritairement hongroise, qui en mars 1990 a été la scène d’un conflit ouvert entre Roumains et minorité hongroise (dans le pays), conflit qui a été alimenté à la télévision roumaine par des messages populistes de type alarmiste qui annonçaient une éventuelle perte de la Transylvanie. Cet épisode annonçait indirectement la campagne électorale de mai 1990 où va résonner le même type de slogans démagogiques, fausse-monnaie des élites coupées du peuple. À l’issue de ce conflit manipulé par les services secrets roumains et amplifié médiatiquement, le régime de Ion Iliescu sort couronné comme protecteur des intérêts des Roumains et remporte les élections : affirmer remplacer la solidarité nationale anticommuniste par une solidarité roumaine antihongroise (et la valorisation du thème du consensus national) s’explique par l’adoption d’un discours qui renforce le sentiment de sécurité des gens en promettant une stratégie de réforme lente et en garantissant le maintien des anciens privilèges (subventions des prix énergétiques, des prix alimentaires, maintien du taux de chômage dans des limites très basses, etc.) à la différence des messages des partis historiques, plus attachés à l’idée de justice morale et donc de condamnation du communisme, favorables à la rétrocession des propriétés nationalisées par le régime communiste, à une thérapie de choc, etc.
** : cf. aussi : “Au tournant des années 1930, la Roumanie n’est pas le seul pays d’Europe Orientale dont la majorité des citoyens rejettent les institutions empruntées à la tradition parlementaire occidentale. Ces formes politiques s’étaient en effet avérées impuissantes à résoudre des tensions sociales sans révolution économique et incapable de surmonter, dans le cadre d’un Etat tirant sa légitimité d’une version mono-ethniste de l’histoire, les contradictions entre légitimité et souveraineté engendrées par les conflits des nationalités” (Claude Karnoouh, « Esquisse d’une histoire sociale, politique et culturelle de la Roumanie moderne », in Transitions – Ex-revue des pays de l’Est n°1&2, vol. XXXVI , 1995, p. 19).
◘ L’assassinat de Codreanu
En avril 1938, Codreanu est arrêté pour la dernière fois, toujours sous prétexte d’une accusation cousue de fil blanc. On l’accusait de s’être mis en rapport avec une puissance étrangère, pour déclencher une révolution sociale en Roumanie. Après un procès aussi surréaliste qu’indescriptible, où la défense entonnait ses plaidoyers dans une salle vide et où les avocats, venus de province, étaient menacés d’être envoyés dans un camp de concentration s’ils quittaient la ville, Codreanu est condamné à dix ans de travaux forcés, en dépit du fait qu’aucune des accusations portées contre lui n’avait tenu à l’analyse. Dans son Journal de prison, Codreanu nous parle de ses conditions de détention. Que le lecteur s’y réfère (en franç. : Journal de prison, Pardès, Puiseaux, 1986).
Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1939, une série de détenus doivent quitter la prison pour être transférés dans une autre forteresse. Le lendemain, un communiqué officiel tombe : « Le convoi automobile transportant les prisonniers a été attaqué ; les prisonniers ont tenté de s’enfuir dans le brouillard. La police a alors fait usage de ses armes et, parmi les victimes, on compte Corneliu Zelea Codreanu, condamné a dix ans de travaux forcés ». Deux ans plus tard, Dinulescu, Major de gendarmerie, est entendu par une commission d’enquête, formée par la Cour du Tribunal de Bucarest ; il fait la déclaration suivante : « Le 29 novembre, à dix heures du soir, le Premier Ministre lui explique que les condamnés pour motifs politiques doivent être exécutés. On les a alors retirés de leurs cellules et amenés vers un camion ; nous avions reçu l’ordre de les asseoir de façon telle qu’ils ne pouvaient plus que tourner leur regard vers l’avant ; les bras étaient liés dans le dos. Derrière chacun d’eux se trouvait un gendarme »..
Dinulescu poursuit : « Sur l’autoroute, dans la grisaille du matin du 30 novembre, j’ai donné le signal convenu au moyen d’une lanterne. Chacun des gendarmes a alors retiré de sa poche une corde, qu’il a noué autour du cou du légionnaire assis devant lui. C’est de cette façon que l’Oublié (ndr : c’est ainsi qu’il était convenu de désigner Codreanu après son internement) et ses 13 camarades ont été étranglés (…). Peu de temps après leur étranglement, nous sommes arrivés dans la capitale et nous nous sommes dirigés vers la prison de la forteresse, où l’on avait préparé, depuis 3 jours déjà, une grande fosse. Après l’arrivée du camion dans la forteresse, sur ordre du Colonel-Procureur de l’Armée de Terre, on a chaque fois tiré un coup de revolver ou de fusil sur les cadavres des étranglés. Les cadavres ont ensuite été jetés dans la fosse (…). Quelques jours plus tard, les cadavres ont été déterrés et réenterrés dans une autre fosse. Après qu’on ait jeté sur eux une grande quantité d’acide sulfurique, on les a recouverts de terre, puis on a coulé une couche de ciment. (…) les gendarmes ont dû signer une attestation de décès signalant que les quatorze légionnaires avaient été abattus en tentant de fuir. Chacun des gendarmes a été récompensé par une somme de 20.000 deniers ».
Ce crime particulièrement sanglant et abject donne le signal d’une campagne visant à éliminer physiquement tous les légionnaires. Pour l’appareil policier, la persécution a été aisée : il possédait des listes détaillées, mentionnant les noms de tous les légionnaires. Codreanu, en effet, avait interdit de se dissimuler dans l’anonymat. En septembre 1939, la Légion riposte : elle assassine le Premier Ministre. Immédiatement après cette exécution sommaire, les vengeurs du Capitaine prennent l’immeuble de la radio d’assaut et annoncent pour tout le pays : « Nous avons accompli notre douloureux devoir ; nous avons puni le bourreau ». Neutralisés et capturés, ces hommes seront exécutés sur place. Leurs cadavres seront laissés tels quels sur le lieu de l’exécution pendant 9 jours, exposés près d’un pont. Le martyrologe de la Légion n’eut plus de fin. Chaque jour, des membres de la Légion étaient arrachés à leur famille, abattus, étranglés, battus à mort lors de leur audition. Les autorités n’hésitèrent même pas à enterrer les cadavres dans des cimetières réservés aux animaux.
► M. Fischer, Orientations n°13, 1991. (extrait d’un article paru dans Die Saufeder, n°3, 1991)
◘ Bibliographie
• Mariano Ambri, I falsi fascismi. Ungheria, Jugoslavia, Romania, 1919-1945, con un saggio introduttivo di Renzo De Felice, Jouvence, Roma, 1980.
« L’intérêt et la valeur du livre de Mariano Ambri sont remarquables sur plus d’un point, à mon avis,… Il a senti le besoin de soumettre à discussion un certain schéma conventionnel, pour le rejetter, il a examiné de près 3 cas concrets relevant, disait-on, du “fascisme unique” ; il en est arrivé à la conclusion qu’en réalité, ces cas étaient de “faux fascismes” » (Renzo De Felice, dans son introduction). Les 3 cas examinés par Ambri sont le mouvement des “Croix Flèchées” en Hongrie ; le mouvement Oustacha en Croatie et la Garde de Fer roumaine. Trois domaines où il n’existe presque rien en langue française.
• Michele Rallo, L’epoca delle rivoluzioni nazionali in Europa (1919-45), vol. III, Romania, Ed. Settimo Sigillo, Roma, 1990.
Ouvrage d’excellente vulgarisation sur le nationalisme roumain. Les chapitres successifs traitent des ligues nationalistes, de la légion de l’Archange Michel, de la Garde de Fer, du Groupe C.Z. Codreanu, du parti Tout pour la Patrie, du Gouvernement Goga, de la dictature carliste (i.e. celle du Roi Carol), de l’État national-légionnaire, de la dictature du Maréchal Antonescu, de l’occupation soviétique et du gouvernement national roumain en exil. Très bonne bibliographie. Avec une chronologie claire.
• Revue d’histoire du nationalisme révolutionnaire n°2, mars 1989, ARS, Nantes.
Au sommaire de ce recueil de textes : 1) Naissance, développement et échec d’un fascisme roumain (F. Duprat) ; 2) La Garde de Fer de Codréanu (H.G.) ; 3) La Garde de Fer de Codreanu (F. Duprat) ; 4) La fin de la Garde de Fer (H. Sirna) ; 5) Légionarisme ascétique, rencontre avec le chef des Gardes de Fer (J. Evola) ; 6) La tragédie de la Garde de Fer (J. Evola).
◘ Aux éditions Pardès : Journal de prison de Corneliu Z. Codreanu, collection “Omul Nou” dirigée par Faust Brădesco.
♦ Présentation éditeur : Du 19 avril au 19 juin 1938, Codreanu, le chef du Mouvement Légionnaire Roumain (la Garde Fer) a été emprisonné. Ces deux mois passés dans des conditions odieuses entre les murs de la prison Jilava, ont transformé ce héros magnifique en martyr chrétien. Ces annotations brèves, parfois à peine ébauchées, écrites en hâte, nous apprennent le désespoir de l’homme traqué, privé de sa liberté, qui sent autour de lui la haine et qui supporte la torture morale. Mais elles révèlent aussi le jaillissement de la lumière chrétienne. Ces notes ne sont aucunement un testament politique ou un essai politico-littéraire. Ces deux mois d’épreuves ont fait découvrir à Codreanu la triste barbarie de notre siècle. Mais ils lui ont aussi fait contempler les portes impériales de la renaissance humaine. De ces quelques lignes émouvantes, il faut retenir un message essentiel : l’humanité a besoin « d’une école de grande élévation et de grande moralité chrétienne » ; et « douleur après douleur, souffrance après souffrance, supplice après supplice, blessure après blessure sur nos corps et dans nos âmes, et tombe après tombe, ainsi nous vaincrons… »
◘ Recension : CORNELIU CODREANU, HÉROS ROUMAIN ET MARTYR CHRÉTIEN
• Corneliu Zelea Codreanu : Journal de prison, introduction et traduction du roumain par Faust Brădesco, avant-propos de Horia Sima, Pardès, 1986, 80 p.
Les Éditions Pardès publient pour la première fois en français les notes laissées par C. Codreanu ; ces notes nous restituent, avec brièveté et une pathétique simplicité, les réflexions et le comportement qui furent les siens, lors de sa détention dans la prison de Jilava. Période très courte (19 avril – 19 juin 1938), passée « dans des conditions odieuses et démoralisantes », mais intensément vécue spirituellement. Car, ainsi que le précise Faust Brădesco dans son Introduction : « Ses réflexions et son comportement pendant cette courte période n’évoquent pas un effort doctrinal pour expliquer le phénomène légionnaire ou pour approfondir davantage ce qui constituait sa pensée politique. Il y a plutôt une tentative : mettre en application la substance d’une doctrine qui arrache l’individu au joug de la matière pour le porter vers la plénitude spirituelle ». Cependant, afin de profiter avec fruit de cet opuscule, le lecteur doit, au préalable, se remémorer brièvement les lignes de faîte, véritables « lignes de foi », spirituelles autant que temporelles du Mouvement Légionnaire roumain (La Garde de Fer) et surtout de son chef, le Capitaine C. Codreanu, son fondateur.
Face à la décadence morale, à l’affaiblissement spirituel, au triomphe des forces négatives du matérialisme qui caractérisent le XXe siècle, et afin de répondre à la « nécessité impérieuse de sauver la nation roumaine du danger qui la menaçait du dedans et du dehors », le Capitaine, répudiant les fausses voies démo-libérale et marxiste, a surgi et « a fait son choix ». Optant pour la voie de la spiritualité chrétienne, il mit l’accent sur « l’Aventure verticale du dépassement », considérée comme une symbiose entre la théorie politico-sociale et la spiritualité. En conformité avec la pensée traditionnelle, le Capitaine pose le postulat de l’interdépendance du spirituel et du temporel, « le rapport indestructible qui existe entre la vie sous toutes ses formes (politique, sociale ou autre) et la divinité ». Le remède aux maux du monde moderne passe par le triomphe des valeurs positives, et pour cela, une réactivation des potentialités spirituelles de l’homme, réalité concrète et fondamentale en tant qu’individu, est nécessaire ; car « l’homme est l’élément exceptionnel de la nature et de la société ».
Dès lors, l’homme devient le champ d’application privilégié de la pensée de Codreanu et, partant, du Légionnarisme. Se régénérant lui-même par un effort spirituel et transcendant, l’homme, devenant « homme nouveau » par l’affirmation d’« une nouvelle conception de vie », dont l’édification ne peut avoir lieu que par une volonté de « re-structuration », régénère spirituellement et matériellement la société, le collectif. Codreanu a reconnu la nécessité « de la transformation intime de l’homme (…), d’agir sur les esprits et de les remodeler sur des principes capables d’arracher l’homme à l’influence néfaste du matérialisme et de l’égoïsme ». D’où un « appel permanent à la dimension transcendantale, un dépassement de la matière, un renversement des valeurs courantes ». Ce dépassement absolu — même s’il « est certain que tous ces dépassements trouvent toujours un écho social, donc collectif » —, ne peut se produire que dans l’ordre de l’individuel. L’illustration de ce dépassement spirituel absolu se concrétisera, de la façon la plus haute, dans l’expérience que le Capitaine vivra dans l’univers carcéral de Jilava.
Une lecture attentive et méditative de ce texte soulève, parmi d’autres, une question importante : la pensée de Codreanu n’apparaît-elle pas comme un “humanisme” ; il est, bien entendu, radicalement différent de la doctrine morale bourgeoise du même nom, ainsi que de celle de la stupide “Religion de l’humanité” qu’Auguste Comte voulut substituer à celle de Dieu. Il s’agit là d’une exaltation d’un “moi” collectif à l’échelle planétaire, d’un anthropocentrisme universel négatif, où l’homme est une fin en soi, coupé de toutes dimensions transcendantes, supra-humaines et divines. “L’humanisme” de Codreanu et de la Garde de Fer est spirituel ; l’homme y est conçu à la fois comme “plateforme” et “vecteur”, en vue d’une expérience et d’un devenir spirituels ; sujet et objet d’une quête spirituelle. Par le dépassement qu’elle implique obligatoirement, par le sacrifice (pouvant aller jusqu’au martyre) qu’elle impose, cette quête aboutit à l’atteinte de la plénitude spirituelle. “L’humanisme légionnariste” apparaît alors comme appartenant à la catégorie du vaste Humanisme chrétien ; il n’en constitue qu’un mode d’application particulier. Cette limite absolue et ineffable sera atteinte par le Capitaine, au fond de son cachot ; alors que les forces mauvaises se déchaînaient au-dehors, il recevra intérieurement la Lumière divine et liera son devenir à “l’être” infiniment parfait et éternel de l’Esprit suprême qu’est Dieu.
Tout bien considéré, cet opuscule montre cette issue comme l’aboutissement logique, dans l’ordre du manifeste et du contingent, de la théorie des « trois cercles légionnaires », conçue comme une globalité : ce sont la « conception légionnaire de la vie », le « monde légionnaire », défini en termes de sacrifice, d’exaltation spirituelle, de luttes, etc. et l’« univers légionnaire », englobant, transcendant et perfectionnant les deux premiers cercles. En ce sens, le parcours existentiel et spirituel du Capitaine, le conduisant à la mort, apparaît comme une voie légionnaire éminemment archétypale, un parcours “complet”, pourrait-on dire, tel qu’il peut se présenter à tout légionnaire ; il constitue la “Voie royale” pour atteindre l’état parfait de Légionnaire de l’Archange Michel.
Beaucoup plus profondément, ce petit livre à la matière décidément très riche, qui ne cesse de nous interpeller, ne manque pas de mettre en relief, bien qu’indirectement, la parfaite adéquation qui exista entre la théorie des trois « Épreuves légionnaires » et l’existence même du Capitaine. Le légionnaire, au cours de sa quête spirituelle et temporelle, doit s’attendre à trouver des embûches que les forces contraires ne manquent jamais d’y semer. Vient alors le temps de ces trois “épreuves”, prévues en tant que telles par le Capitaine lui-même, mais imposées par l’extérieur, « à chaque instant, sous des formes variables mais toujours pénibles », il imposera de suivre la voie de l’honneur, du courage et surtout de la foi, celle qui renforce le courage et durcit la détermination. Ces “épreuves” ne sont certes pas voulues pour elles-mêmes, mais acceptées et endurées afin d’atteindre un but ; elles constituent autant de « portes étroites » pour accéder à la perfection spirituelle, but ultime du légionnaire. Ces trois “épreuves” que le Capitaine eut à subir, à l’instar de tout légionnaire, furent successivement : « l’ascension » de la « Montagne de la souffrance », constituée par les « sacrifices matériels, des premières souffrances physiques et morales » et la lutte intérieure contre « l’inertie, la vanité, l’égoïsme » ; « l’entrée » dans la « Forêt aux bêtes sauvages », « second cycle d’épreuves que rencontre le légionnaire dans son chemin vers la perfection personnelle et la victoire du mouvement ».
Le conflit avec les agents de l’autorité, jusqu’alors latent, devient réel, plus aigu, du fait d’une plus grande intensité de la foi et de l’engagement politico-spirituel du légionnaire. Seuil critique qui met à l’épreuve « le caractère, la force spirituelle, la résistance morale et physique de chaque légionnaire ». C’est enfin, la « traversée du Marécage du désespoir », « parce que celui qui y pénètre est envahi par le désespoir, avant de le traverser ». Période d’incertitude, de doute quant au but ultime à atteindre. « Cependant, ainsi que le précise le Capitaine, les vrais légionnaires ne perdent jamais l’espoir. Ils traversent cette dernière épreuve et atteignent l’autre rive, couverts de gloire ».
Ce Journal de prison nous restitue, précisément, les « derniers mètres » de la traversée de ce « Marécage du désespoir » par le Capitaine, et son accession à la gloire, mais par le martyre ; tant il est vrai que l’appropriation de la gloire passe souvent par la mort. « La gloire est le soleil des morts » a pu écrire Balzac. En fait, cet opuscule nous fait découvrir deux nouvelles « épreuves », essentiellement supra-humaines, que Codreanu n’avait pas prévues, mais qui viennent immédiatement à l’esprit : au sortir du « Marécage du désespoir », il franchit la « Porte du sacrifice et de la mort », instant si « facile » et pourtant si complexe, et atteint, enfin, l’ultime destination que maints martyres chrétiens ont atteinte avant lui : les « Champs de la gloire et de l’éternité », où règne la joie sans fin en Dieu ; ils sont inondés par la Lumière divine permettant de « voir Dieu face à face ».
Destin tragique du Capitaine ; on peut parler véritablement d’une Passion Christique. Tout comme le Christ, mort pour avoir apporté la Révélation divine, enseigné la Vérité et donné le salut au monde par son sacrifice, le Capitaine a souffert et est mort pour avoir apporté au peuple roumain une certaine idée du spirituel et du temporel ; il a essayé de donner à son pays un avenir possible, fondé sur des valeurs positives. Nous sommes là en présence d’une « éblouissante compréhension de la voie qui mène au rachat et à la plénitude », ainsi que l’a écrit Faust Brădesco. De là l’existence certaine du parallélisme entre la vie du Christ et celle du Capitaine, que la « marche au tombeau » de Codreanu, narrée par ce Journal de prison, met, indirectement, en relief.
À l’instar du Christ, Codreanu sa vie durant — il commença, comme Jésus, vers la trentaine, à prêcher une nouvelle doctrine, en rupture totale avec toutes celles existantes, et à réunir des disciples autour de lui, notamment par la fondation de la Légion de l’Archange Michel en 1927 —, ne cessa de prêcher la Voie, la Vérité et la Vie, ainsi qu’il est dit de Jésus dans l’Évangile selon Saint-Jean. Le Capitaine fut la Voie nouvelle qui conduisait à la régénération de l’homme et de la Patrie roumaine, parce qu’il apportait la Vérité et la Vie. De même que le Christ a souffert et est mort pour les hommes, le Capitaine, pour sa Patrie et l’idée qu’il se faisait de l’homme, a beaucoup souffert : il a été persécuté, sa vie durant, par les autorités, emprisonné, torturé physiquement et moralement et finalement assassiné.
Si l’on voulait paraphraser Isaïe, on pourrait dire pour résumer la mission et le destin du Capitaine : « Vraiment c’étaient les maladies de sa Patrie qu’il portait et ses douleurs dont il s’était chargé (…). Il a été transpercé à cause de la lâcheté et de l’indignité de cette Patrie à recevoir son message, broyé à cause des iniquités des autorités (…). C’est par ses meurtrissures, cependant, que sa Patrie sera guérie ». Par les luttes et l’espérance qui l’a toujours guidé, Codreanu était devenu un héros magnifique, l’exemple vivant du légionnaire illuminé par la Vérité et la Foi créatrices. Les 2 mois qu’il passa à Jilava devaient achever le périple : sa transfiguration en martyr chrétien, cimentant par son sang les préceptes légionnaires, l’achèvement de l’élévation de son individualité au-delà des contingences et de sa condition humaine ; l’atteinte de la Vérité suprême ; témoignant, par là même, de la justesse de son combat spirituel et temporel.
Une impression générale se dégage de cet opuscule, outre les nombreuses questions qu’il suscite, questions, — il faut le remarquer —, qui se définissent, pour la majorité d’entre elles, comme “rétrospectives” — car elles obligent le lecteur à toujours faire retour sur le passé de Codreanu et du Légionnarisme — c’est le “mise en page” progressive des éléments d’un drame, d’une Passion, que vit un homme habité, comme tout chrétien baptisé, par le Saint-Esprit — « L’Esprit de Jésus » — ; il s’emplit, dans un effort spirituel intense et « forcé » par le climat tragique où il se trouve plongé, de la Vie divine, lui donnant la force d’être un « Témoin du Christ ». Le martyre qu’il subira le métamorphosera en « Compagnon de Dieu ». C’est avec raison que Faust Brădesco a pu écrire que ces 2 mois représentent « une période, non pas nouvelle, mais différente de tant d’autres que le chef de la Garde de Fer a passées derrière les grilles. Différente, (…) surtout par la transformation spirituelle qui se manifeste en lui ».
Pourquoi et comment Codreanu subit-il cette transformation spirituelle ? On pourrait répondre à cette question en disant, un peu rapidement, que l’être humain, confronté à une situation périlleuse et conscient de sa fin prochaine — étant par nature un « animal religieux » —, a une propension innée à se tourner vers un « Être suprême » ou ce qu’il considère comme son Créateur, apte à l’aider, à le secourir et à assurer le salut de son âme. Dans cette optique, Codreanu aurait obéi “biologiquement” à cette tendance religieuse et métaphysique inhérente à la nature humaine. En fait, ce n’est pas de ce type de réaction qu’il s’agit dans le cas du Capitaine, mais de quelque chose de beaucoup plus profond.
D’abord, nous devons avancer la constatation suivante : le Capitaine était un « chrétien total » — à la foi vraie —, profondément pénétré des Vérités chrétiennes, sachant que l’homme, perdu par le péché originel, ne pouvait ressusciter et être sauvé qu’au sein de la foi dans le Christ, ainsi qu’il l’a écrit dans l’une de ses notes. De plus, il était trop sincère pour chercher à éviter, face aux situations tragiques et mortelles que les événements imposent parfois aux hommes, de tirer les conclusions qui s’imposent, notamment la signification de la mort pour un chrétien, le sens du sacrifice et la valeur positive, sur le plan spirituel, que ce dernier peut acquérir. Mis en face de sa fin prochaine, devenue évidente dès son incarcération, la pressentant même, il les a vécues jusqu’à leur épuisement total.
À partir de là, le “pourquoi” devient évident : pour le chrétien Codreanu, la mort, terme “obligé”, parachèvement total, de sa transformation spirituelle, n’est pas “désespérante”, inutile, ni même une fin, mais au contraire la “belle échappée” de cette “vallée de larmes”, de ce monde « de misère, de mal et de haine », et l’entrée triomphale dans la Vie éternelle et le retour au Père des cieux. Cette transformation spirituelle lui permet d’opérer une approche de Dieu, que la mort physique, après la mort spirituelle au monde extérieur, lui permettra de transformer en communion et fusion totales. Son intégration complète en la Divinité. Quant au “comment”, il est l’objet même du contenu de ces quelques notes tracées par le Capitaine.
Ce laps de temps très court, qui va pendant deux mois constituer l’univers existentiel quotidien de Codreanu, se scinde nettement en deux périodes, bien mises en relief dans cet opuscule : une période d’attente incertaine, puis progressivement de désespoir et de souffrance, mais nous montrant Codreanu qui espère encore en la justice des hommes, d’« un retour dans le monde libre », ainsi que le précise Faust Brădesco. Une évidence s’impose dès la lecture de la première note : cette première période, qui va durer jusqu’au vendredi 3 juin, constitue une « coupure nette » dans la vie du Capitaine : le mardi 19 avril 1938, en descendant l’escalier du Conseil de Guerre et en pénétrant dans le fourgon cellulaire qui doit l’emmener à la prison de Jilava, Codreanu cesse d’appartenir, non seulement au monde libre et vivant, mais aussi à celui de l’action et de la foi associées qui édifièrent, jusqu’à son arrestation, les bases de sa vie de militant, d’homme et de chrétien.
À partir de cet instant, cette union se brise, la foi — qui est « espérance en Dieu » ainsi que l’a écrit Bossuet — constituera désormais, par la force des choses et la situation particulière qui lui est faite, son principal support de vie. L’élément “action” se trouve évacué au profit de la seule foi. Dès ce moment, cette dernière ne va plus quitter le Capitaine, elle va fortifier son esprit et lui faire découvrir les moyens à employer pour assurer son salut. Période de foi, dans le sens que nous venons d’indiquer, mais aussi d’espérances humaines : il espère encore, malgré la situation humiliante dans laquelle il se trouve, la totale dégradation de l’être humain qu’il subit, l’isolement épouvantable qui lui est imposé — « Je ne vois un visage humain que lorsqu’on m’apporte la nourriture » —, en une amélioration de sa situation judiciaire et carcérale.
Cependant, très vite, dès sa comparution devant le capitaine-procureur Atanasiu, il comprend l’inutilité de telles illusions : « Je fus saisi d’épouvante. Car je n’ai plus aucune confiance dans la justice. La justice qui juge d’après un ordre reçu, et non pas selon la conscience, n’est plus une justice ». Les longs interrogatoires, les interminables séances de procédure, l’épuisement qu’il ressent par tant de combats et de victoires réduits à néant par la haine, le souvenir de ses compagnons morts ou emprisonnés, celui de sa famille, joint à son propre désespoir de n’être plus qu’un condamné enchaîné et à la maladie qui le tenaille, lui font céder à la tentation du tourment intérieur et découvrir la misère radicale de l’homme plongé dans une situation précaire.
Mais la source la plus profonde de sa détresse, c’est non seulement dans l’expérience de l’échec de son action politico-spirituelle qu’il faut la chercher, mais aussi dans le sentiment d’injustice de sa position ; ce qui le révolte et l’indigne. Cependant, malgré sa condamnation honteuse et injustifiable à dix ans de travaux forcés, « pour trahison », à la suite d’une parodie de justice, et le « désabusement » — selon un mot de Péguy — qui l’atteint, il demeure la conscience tranquille. « Je suis calme et j’ai la conscience en paix. Je sais que je ne suis coupable de rien ». Et ouvrant le livre des prières de saint Antoine, il tombe sur cette citation illustrant significativement l’injustice qui le frappe : « Que je reçoive calmement tout ce que le Seigneur envoie, en comprenant que c’est Sa volonté ».
La seconde période qui s’ouvre dans la “Passion” du Capitaine, c’est celle de la « certitude spirituelle » et du « compagnonnage divin ». Si la première période fut cruelle pour Codreanu, marquée qu’elle fut par un moment d’attente, d’espoir en la justice humaine – mais qui se révéla, pour lui, vaine parce que justement elle n’était qu’humaine –, puis de désespoir et de souffrance, dès qu’il eut connaissance de la « sentence inique » et terriblement humaine — car seul l’homme est capable d’injustice — qui le frappa, la seconde phase sera pour le Capitaine toute remplie de lumineuse espérance en l’Amour et la Justice de Dieu. Il se produit alors, ainsi que le note Faust Brădesco, « le jaillissement de la lumière chrétienne, lorsque son esprit réalise définitivement l’importance de la modification spirituelle, par le rapprochement et la communion avec la Divinité ». Cette ultime phase, aboutissement de la longue quête politico-spirituelle de Codreanu, est le couronnement, dans la « chaleur de Dieu », du parcours terrestre de cet homme qui franchira « les portes impériales de la renaissance humaine ». Devenant ainsi un « modèle idéal pour tous les membres de la Garde de Fer », et, au-delà, pour tous les chrétiens.
Deux condamnations l’affecteront fortement. La condamnation aux travaux forcés par la justice des hommes, vis-à-vis de laquelle Codreanu ne se faisait plus d’illusion – rejointe peu de temps après par le rejet de son recours par la Cour de Cassation Militaire – ; mais surtout la condamnation, à l’instar du Parti national-socialiste de Hitler et l’Action Française de Maurras durant l’entre-deux guerres, par l’Église, du Mouvement Légionnaire. Lui qui s’est toujours voulu « l’enfant de la Foi », fidèle et chérissant son « père », duquel il attendait énormément ! Et voilà maintenant que ce « père » le rejette, « le regarde froidement et le frappe sur la bouche, en lui brisant deux dents ». Pourtant, il n’a pas eu conscience de faillir. « Nous combattons, nous nous sacrifions, nous tombons, le sang jaillit de nos poitrines pour défendre les églises… et l’Église nous dénonce, comme « dangereux pour le peuple », comme « égarés », comme « étrangers à la Nation »… Ainsi devait conclure le Capitaine : « Quoi qu’il en soit, c’est douloureux, extrêmement douloureux (…) ».
Cette condamnation de l’Église, corps et épouse mystiques du Christ, fut la plus dure des atteintes qu’il dut endurer durant cette période. Car « comment imaginer l’ébranlement spirituel, la tragédie provoquée dans (l’) âme par ce coup inattendu ? ». Cet « ébranlement spirituel » se traduisit, pour le Capitaine, par son éloignement de l’« Église mondaine », pour se rapprocher de l’« Église invisible » du Christ, l’Église triomphante, en quelque sorte, celle constituée par les esprits célestes et ceux qui ont su résister au démon. Ce « rapprochement spirituel », avec « prise directe sur le divin », lui est « facilité » par le fait qu’il ressent, dans le monde clos au sein duquel il est plongé, la présence des morts, de « ses » morts. « Toute la journée je me trouve seul et je parle à tour de rôle à ceux d’entre nous qui sont déjà morts. (…). Je les vois (…). Ils restent auprès de moi », précise-t-il.
C’est à une réelle Communion des Morts, une Communion des Saints, à l’instar de Maurras, auxquelles se livre Codreanu ; rendues possible par les sentiments d’amour mutuel existant entre membres d’une même communauté de race, d’idées, et surtout une commune appartenance à une même Église. Il nous fait part alors de la douleur qu’il ressent de voir tant de « bons Roumains » tués, torturés ou disparus ; et dont beaucoup « d’entre eux sont déjà passés par Jilava : Mota, Marin, Ciumeti, (…) ». Cette Communion des Morts ne peut que le détacher davantage de l’« Église terrestre », pour le rapprocher de Dieu et lui permettre de faire siennes l’Espérance et l’Immortalité de l’âme. « Christ est ressuscité en semant l’espérance de la résurrection : l’espérance que notre vie ne finit pas ici, (…) ; qu’elle se prolonge dans l’au-delà : que nous rencontrerons les plus chers des nôtres (…) ». Ce fil de l’espérance qu’il sentit un moment se briser face à « la pensée de la souffrance, des humiliations, des brutalités supportées par les miens ». La lecture des quatre Évangiles lui permit de renouer ce fil. « Quand je les eus terminés, j’ai senti que je possédais à nouveau ces trois fils et qu’ils étaient parfaits : la foi, l’espérance et l’amour ».
Le parallélisme entre son Calvaire — véritable « montée au Golgotha » — et celui du Christ, qui n’est pas blasphème ni orgueil, « mais tout simplement éblouissante compréhension de la voie qui mène au rachat et à la plénitude », s’impose alors totalement à son esprit. Comme le Christ, « Tous l’ont condamné à ce qu’il fût puni de mort ». Ils le lièrent et « l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate ». Mais le peuple, auquel le Christ, comme Codréanu, avait apporté tant de biens, exigea de Pilate que l’Homme soit crucifié et Barabbas libéré. La seule différence entre l’époque du Christ et celle du Capitaine, est que les Barabbas roumains n’avaient pas à être libérés. Ils étaient libres et régnaient même dans les hautes sphères politiques de la Roumanie. La souffrance leur devient alors commune. Dieu enleva à Jésus ses pouvoirs, comme les siens lui furent ôtés par la privation de sa liberté, « Le laissant simple homme – comme moi, comme nous tous. Pour qu’Il souffre en tant qu’homme ! Pour que Sa souffrance soit sans égale : ce n’est qu’ainsi qu’il aura le pouvoir de rachat ». « Voilà pourquoi Il a pensé, Il a souffert, Il a espéré jusqu’au dernier instant, comme nous ». Comme le Christ, le Capitaine a connu la trahison, la haine, l’injustice, l’emprisonnement et, finalement, la mort. Mais, le Christ n’était pas seul lors de sa montée au Calvaire. « Derrière Lui, venaient deux femmes et une multitude qui pleurait », précise Codréanu. Ne peut-on pas y voir une allusion, faite par celui-ci, à sa mère et à sa femme, et à la « multitude » des membres de la Garde de Fer, qui l’accompagnèrent, lui aussi, dans ce long « Chemin de croix » que furent les derniers mois de son existence ?
Ainsi s’accomplit en lui, après la prise de conscience de la « présence divine dans la vie de l’homme », la transformation intérieure qui, « au fur et à mesure que le temps passe, et que ses réflexions le portent vers une compréhension métaphysique et spirituelle de la perfection humaine », le fait accéder à la sérénité et à la plénitude. De ce fait, de virtualité qu’elle était dans la doctrine légionnaire, l’orientation spirituelle et métaphysique de la vie devient réalité sacrée. Et comment mieux conclure que par ces quelques lignes de Faust Brădesco : « Les trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité, qui constituent aussi l’essence de la doctrine légionnaire, ouvrent à l’« homme nouveau » (conçu et mis en relief par la Garde de Fer) le chemin de la perfection morale, de la raison équitable et de l’élévation spirituelle ». Nul doute que le Capitaine fut le “voyageur” qui emprunta ce dur et lumineux “chemin”. Avec comme point d’orgue, la Mort. Mais qu’importe, puisque « Dieu voit et récompensera ! ».
► Bernard Marillier, Kalki n°4, Pardès, 1987.
• Dessins de B. Marillier : La Victoire (inspirée d’une couverture d’un livret de chants légionnaires), La Grille et le loup de Dacie (“Le Pays des Loups“), La Grille et le Christ.
[Ci-dessus : Carte ethnique de la Roumannie pendant l’entre-deux-guerres. 30 % de la population était non-roumaine. Dans ce tiers de la population, on comptait 26 % de Juifs, 25 % de Magyars et 14 % d’Allemands (surtout en Transylvalnie et dans le Banat) et 10 % d’Ukrainiens (surtout en Bessarabie/Moldavie)]
• Analyse : Armin HEINEN, Die Legion “Erzengel Michael” in Rumänien : Soziale Bewegung und politische Organisation. Ein Beitrag zum Problem des internationalen Faschismus, R. Oldenbourg Verlag, München, 1986, 558 p.
L’ouvrage d’Armin Heinen, consacré au mouvement de Codreanu, diffère de beaucoup d’autres travaux consacrés à la Garde de Fer et aux tumultes de la politique roumaine de l’entre-deux-guerres. Il en diffère parce qu’il explore à fond le contexte historique de la Roumanie depuis son émergence en tant qu’État et parce qu’il résume, de manière limpide et pédagogique, les multiples linéaments de l’idéologie nationale roumaine. Ce sont ces pages-là que nous analyserons dans le présent article, laissant de côté — mais pour y revenir plus tard — l’exposé brillant et détaillé des événements politiques du terrain que Heinen nous livre dans son remarquable ouvrage.
Au XIXe siècle, les principautés roumaines (la Moldavie et la Valachie), en s’émancipant de la tutelle ottomane, entrent automatiquement dans un champ conflictuel, excitant la convoitise des puissances voisines, l’Autriche-Hongrie et la Russie. La société, marquée par l’orthodoxie aux réflexes ruraux et par l’idéologie guerrière turque/ottomane, reçoit comme de mauvais greffons les éléments épars de l’occidentalisme, le libéralisme économique et politique. La société roumaine est affectée par une cascade de crises dues aux facteurs de modernisation : dans une société accoutumée à la dépendance voire au servage, l’émancipation moderne ébranle les structures sociales.
En amont, chez les dirigeants, les principes individualistes, propres à la modernité politique, disloquent le sens du devoir de solidarité et de charité, plongeant du même coup les masses rurales dans la perplexité puis dans la colère. En aval, dans les masses, le respect pour les élites traditionnelles s’estompe et, vis-à-vis des élites importées ou de la bourgeoisie urbaine émergente, éclot une haine qu’il sera de plus en plus difficile de contenir. Pour les masses, les élites traditionnelles ont succombé aux tentations du mirage occidentaliste ; elles ont basculé dans le péché, en oubliant leurs devoirs paternalistes de solidarité et de charité. Les élites importées et les élites urbaines (ou fraîchement urbanisées) sont, elles, les tentatrices, les vectrices du péché.
Le poporanisme, équivalent roumain du narodnikisme russe
Dans un tel contexte, à terme explosif, se profilent 4 filons idéologiques, dont 3 sont calqués sur leurs équivalents ouest-européens : le libéralisme, le conservatisme, le socialisme ; 4ème filon, le “poporanisme”, lui, est “national” (au sens ethnique) et paysan, c’est-à-dire attaché aux modulations traditionnelles des relations sociales. Le libéralisme roumain est coincé entre une volonté théorique de démocratisation et la défense effective d’intérêts précis (ceux de la bourgeoisie « parvenue » et importée). Le conservatisme roumain est, quant à lui, immobiliste : raisonnant en termes d’idéaltypes conservateurs figés, il refuse de prendre en compte toutes les modifications politiques survenues après 1848.
Dans le conservatisme roumain, émerge tout de même une figure intéressante, celle de Constantin Radulescu-Motru, auteur de Cultura româna si politicianismul (La culture roumaine et la politicaille). Radulescu-Motru estime que les Roumains, par manque d’énergie, n’ont pas transformé leur culture rurale du départ en une culture plus vaste, plus générale, plus viable, semi-urbaine, ou d’une urbanité non oublieuse de ses racines, à la mode allemande. Dans cette ruralité demeurée primitive et en conséquence fragilisée, des “politicards” et des “avocats”, rusés et spéculateurs, ont instrumentalisé des idées étrangères, occidentales, ont rationalisé à leur profit l’appareil étatique, pour prendre la place des élites déclinantes et pour barrer la route à toute élite nouvelle, issue du peuple roumain, qui se profilerait à l’horizon.
Une doctrine de l’État démocratique paysan
Le socialisme roumain, enfin, est un socialisme sans ouvrier, dans un pays aux structures industrielles peu développées. Le poporanisme, spécificité roumaine, élabore une doctrine de l’État démocratique paysan, optant pour une voie non capitaliste. Le poporanisme est donc bel et bien une expression de l’ethnicité rurale roumaine, orpheline de ses élites et haïssant les nouveaux venus dans la société roumaine. Il est démocratique parce qu’il estime ne plus avoir d’élites traditionnelles ou a perdu toute confiance dans les éléments qui subsistent de celles-ci. Les dominants traditionnels ayant dérogé, le peuple roumain doit prendre son destin en mains : ses élites doivent sortir directement de ses rangs. Mais son caractère démocratique ressort également parce qu’il refuse toute domination des masses rurales par de nouvelles élites dans lesquelles il ne se reconnaît pas. La voie est non capitaliste parce que le capitalisme est porté par des éléments non issus de ces masses rurales.
L’idéologie poporaniste se base, au départ, sur les écrits de Constantin Stere (1865-1936, surnommé “Şărcăleanu”), un socialiste qui a refusé le marxisme et s’est inspiré des narodniki russes (et orthodoxes). Le terme narodniki vient de narod (peuple), comme “poporanisme” vient de popor (peuple) (cf. C. Stere, « Socialdemocratism sau poporanism », in Viata românesca, 2, 1907-1908). Stere refuse le marxisme parce qu’il ne convient pas à un pays à forte dominante agraire comme la Roumanie. L’idéologie marxiste a été incapable de produire un discours cohérent sur les masses rurales. Le modèle de l’idéologue populiste-paysan roumain est le Danemark (qui, en Grundvigt, avait eu son théoricien-poète de la ruralité et de la populité, initiateur du courant d’idées folkelig, de l’adjectif dérivé de folk, “peuple”). Le Danemark a su conserver intact son paysannat ; par un réseau de coopératives, il a rendu les petites fermes familiales viables et les a couplées au monde industriel.
En termes plus enthousiastes, G. Ibrăileanu, un disciple de Stere, imagine une Roumanie démocratique, avec un Parlement de petits producteurs et une armée de paysans-soldats, à la mode des Boers sud-africains ; ces chefs de famille permettraient à leurs cadets, filles et garçons, d’étudier des matières culturellement enrichissantes, à l’université ou dans les conservatoires, générant ainsi une nouvelle élite intellectuelle ayant acquis ses qualités en dehors de toutes préoccupations utilitaires. Contrairement aux conservateurs, les poporanistes se considéraient comme les successeurs des révolutionnaires de 1848. Mais, comme les conservateurs du mouvement Junimea [Jeunesse, créé en 1863 par Maiorescu], ils refusaient d’inclure dans leur vision idéale de la société, les éléments non issus des masses rurales.
[ci-dessus : Gabaret Ibrăileanu (1871-1936), auteur d’un important ouvrage sur la culture roumaine, Spiritul critic in cultura romaneasca (1909, L’esprit critique dans la culture roumaine). Il s’est penché sur les modalités d’introduction de la culture occidentale dans les pays roumains. Il a souligné le rôle de la Moldavie dans la conservation du caractère national]
Les piliers d’un nationalisme ethnique, farouchement anti-occidental
Le conservatisme du mouvement Junimea, dont Radulescu-Motru fut le principal théoricien, et le poporanisme ruraliste de Stere et Ibrăileanu sont les 2 piliers de l’anti-occidentalisme roumain, dont la Garde de Fer sera, plus tard, un avatar radicalisé. Ceci dit, Stere refusera toujours la radicalisation légionnaire ; demeurant rationnel et fidèle à son « modèle danois », basant ses arguments sur des statistiques et sur des observations empiriques, se bornant à déplorer l’accroissement trop rapide des populations non roumaines en Roumanie (et des Juifs en particulier), Stere restera éloigné de toutes les déformations mystiques de son socialisme agrarien.
Sur cette double généalogie idéologique, s’est greffé un antisémitisme qui, dans un premier temps, était principalement littéraire. Des figures comme Mihail Eminescu [ci-contre], Aurel C. Popovici et Nicolae Iorga effectueront, petit à petit, la synthèse entre le populisme roumain, conservateur ou poporaniste, le nationalisme inspiré des autres nationalismes européens et de l’antisémitisme. Parmi les leitmotive de cette synthèse : la modernité, en accordant un droit égal à tous, confisque aux paysans pauvres, porteurs de la substance ethnique roumaine, l’égalité des chances ; la société moderne, impliquant la division du travail, induit un clivage entre producteurs (paysans et artisans) et « parasites » (commerçants et spéculateurs). L’antisémitisme qui découle de ces ressentiments sociaux présente toutes les nuances et gradations du genre : pour les uns (Iorga et Eminescu), les Juifs sont assimilables s’ils adoptent des « métiers productifs » ; pour Stere, qui raisonne en termes rationnels, la naturalisation demeure possible, si les Juifs s’adaptent à la culture roumaine (ce qui revient en fait à adopter les mêmes métiers que les Roumains) ; pour d’autres, comme V. Alecsandri, B.P. Hasdeu, N.C. Paulescu et Alexandru C. Cuza, toute vie en commun avec les Juifs est impossible. Comment justifient-ils cette exclusion sans appel ? En mettant en avant, comme beaucoup d’autres antisémites européens, des citations du Talmud (Rohling, Rosenberg, Picard, etc.). Pour cette tradition anti-talmudiste, l’existence du Talmud dans l’héritage spirituel juif interdit l’assimilation et la coexistence pacifique.
Nicolae C. Paulescu [ci-contre] introduit cependant des nuances : la substance populaire roumaine n’est pas tant menacée par la concurrence économique de l’élément juif que par la perte des « directives restreignantes ». Une société rurale est une société « économe », épargnante, qui restreint ses pulsions vers la consommation. Le rôle de la morale est de pérenniser cette propension à la restriction, pour que la société ne perde ni son équilibre ni son harmonie. A.C. Cuza introduit dans ce discours des éléments tirés de Malthus : 2 peuples, les Roumains et les Juifs, ne peuvent pas vivre « dissimilés » sur un même territoire, sans que n’éclate une guerre à mort.
Le divorce entre le peuple et l’élite
Pour Eminescu, la Roumanie est passée de l’obéissance aux Turcs à l’obéissance à l’étranger (hongrois, juif ou allemand), parce qu’en 1878, au Congrès de Berlin, qui instaure l’indépendance définitive de la Roumanie, les puissances imposent comme clause que les non orthodoxes peuvent acquérir la citoyenneté roumaine, introduisant de la sorte une cassure difficilement surmontable entre la ville et la campagne. Cette cassure marginalise une intelligentsia brillante, de souche paysanne et roumanophone, très nombreuse et privée d’avenir parce que les postes sont déjà occupés dans les villes, par les francophiles, les fils urbanisés et francisés des boyards (dénoncés surtout par Iorga), les Juifs, les étrangers. L’idéal de ces laissés-pour-compte, c’est une culture authentiquement roumaine qui puisse accéder à l’universel, être appréciée dans le monde entier, exprimer la créativité profonde de l’âme roumaine aux yeux de tous les peuples de la planète, souder la solidarité des Roumains vivant à l’intérieur et à l’extérieur des frontières du royaume.
Cet idéal, les Roumains sentent qu’ils ne pourront le réaliser. Raison pour laquelle leur nationalisme, au début du XXe siècle, est le produit d’une « conscience malheureuse », de doutes et de peurs. Les Roumains ont l’impression, en 1900, que, dans le siècle qui s’annonce, ils auront le statut d’« ilotes ». Heinen (pp. 86-87) résume ce passage au nationalisme angoissé chez Eminescu : « [Chez Eminescu], la nation apparaît comme une essence spécifique, qui déploie ses propres revendications et a sa propre personnalité. Elle se trouve au-dessus de l’idée de liberté individuelle, ce qui veut dire qu’elle ne se constitue pas par la volonté de ses membres mais est un donné naturel se situant au-delà d’eux. Le sens qu’acquiert la vie individuelle d’un chacun existe par la Nation et pour la Nation. Le corps populaire menace toutefois d’être détruit à cause de la lutte des classes, principe égoïste, rendant impossible le don de soi à la Nation. L’inégalité, résultant de la division du travail social, et les conflits qui en découlent doivent être limités par la conscience d’une appartenance à la Nation. Quant à A.C. Cuza, il estime que la réalité Roumanie ne réside pas dans la lutte des classes mais dans la lutte des races, c’est-à-dire dans la question de savoir si ce sont des Roumains ou des Juifs qui conduiront le pays ».
Un vigoureux plaidoyer contre la « raison pure »
[Ci-dessous : page de titre de Die Vereinigten Staaten von Groß-Österreich (Leipzig, 1906) écrit par le publiciste roumain-transylvanien Aurel Popovici (1863-1917). Ce dernier est aussi connu pour avoir, au nom du principe de nationalité au sein de l’empire austro-hongrois de François-Joseph, prôné une transition vers une fédération de territoires, correspondant à une nationalité et jouissant d’une autonomie administrative du type de celle des cantons suisses : les “États-Unis de la Grande Autriche“, cf. La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie (1918), « Les historiens transylvains-roumains et l’Autriche-Hongrie », C. Durandin in Austriaca n°18/1984, et la brochure Aurel C. Popovici : un précurseur de l’européisme, éditée par la Fondation européenne Dragan, 1980]
Aurel C. Popovici introduisit dans la littérature roumaine la critique conservatrice moderne des fondements du libéralisme. Appuyée sur les travaux de Burke, de Joseph de Maistre, de Gustave Le Bon, de Taine, Langbehn, Houston Stewart Chamberlain et Gumplowicz, sa démarche vise essentiellement à déconstruire le mythe de la raison pure. Heinen la résume comme suit (p. 87) : « L’œil humain n’a pas été créé pour ne regarder que le soleil. Nous ne pouvons pas éduquer nos jeunes gens pour n’être que de purs savants ; nous aurions pour résultat une catégorie sociale de demi-cultivés ridicules, avançant des prétentions irréalisables […]. La raison pure dissout tout, remet en question les structures traditionnelles et met ainsi en danger l’intégration sociale […]. Sans religion, les gens simples du peuple perdent leur retenue morale, la haine sociale et l’envie “rongent des trous” dans la vie spirituelle de la nation ». Popovici estime que tous les maux du monde moderne sont réunis dans la démocratie. Par le fait qu’elle hisse les intérêts matériels de la plèbe insatiable et égalitariste au rang de source des décisions politiques, nous voyons nécessairement naître un monde de démagogie, de lutte des classes, orienté seulement vers la satisfaction des intérêts particuliers et éphémères. La ville moderne reflète d’ores et déjà, pour Popovici, cette dégénérescence des mœurs politiques.
À la décadence de la Roumanie de la fin du XIXe siècle, les nationalistes opposent, nous explique Heinen (p. 89), la grandeur nationale des XVe et XVIe siècles ou évoquent les Daces. Les nationalistes roumains préféraient d’office tout ce qui s’était passé avant 1800, les époques de simplicité patriarcale, où règnait une solidarité naturelle entre paysans, boyards et lettrés. L’assaut des mœurs occidentales délétères, la pénétration en Roumanie d’éléments étrangers a ruiné définitivement cette harmonie.
Un César lié au peuple
Mais les nationalistes ne veulent pas pour autant d’un retour au Moyen Âge. Les innovations de la modernité, notamment dans les domaines économique et militaire, doivent être assimilées et soumises à des principes directeurs pré-modernes. L’évolution de la société doit être graduelle, mais c’est le paysannat de souche qui doit la contrôler, de façon à ce qu’il demeure toujours la classe sociale dominante. Pour chapeauter ce paysannat, les nationalistes réclament une monarchie héréditaire, se plaçant au-dessus des classes sociales ; le monarque souhaité n’est pas absolu : il devra être un César lié au peuple. À ses côtés, devra se trouver une oligarchie politique capable de comprendre l’évolution naturelle des choses.
Raisonnant sur un mode « évolutionnaire », rejettant toute forme de rupture révolutionnaire, A.C. Cuza et N. Iorga préconisaient une démocratie constitutionnelle, ayant pour organe législatif un parlement des états, calqué sur ceux de l’Ancien Régime mais adapté aux impératifs de l’heure. Contrairement à Popovici, influencé par les idéologèmes sociaux-darwiniens, Cuza et Iorga préconisaient l’intervention de l’État, notamment dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnelle, parce que le retard économique de la Roumanie était dû, pour une bonne part, à l’absence de corps de métier, de maîtres éducateurs, de gildes, d’instituts agronomiques. Eminescu, Iorga et Cuza réclamaient le partage des grands domaines au profit de groupes, familiaux ou villageois, composés de petits paysans. Cette revendication distingue les nationalistes des conservateurs, pour qui l’État agrarien doit être dirigé par les gros propriétaires et pour qui l’individualisme de type occidental ne doit pas être abandonné et/ou éradiqué au profit d’un don total de la personne à la nation.
L’influence de la revue “Sămănătorul”
Après la Première Guerre mondiale, quand la donne change de fond en comble, le poporanisme de Stere se transforme en “taranisme” (de tsara, paysan). Le néo-nationalisme gardiste prend une coloration mystique, absente chez Iorga et Cuza. Le projet de fonder un système d’éducation rationnel, mettant l’accent sur l’agronomie et le développement des corps de métier, cède le pas, dans l’idéologie gardiste, à une éducation de type militaire (milice de Dieu) et activiste. Ce glissement vers le mysticisme armé et politisé, s’est opéré, graduellement, par l’intermédiaire d’une revue très lue, Sămănătorul (Le Semeur), dont Nicolae Iorga fut pendant un certain temps le rédacteur-en-chef. Le “samanatorisme” esquissa, dans le monde des lettres roumain, l’image d’un village où vivent 2 peuples, selon des modes très différents. D’un côté, la Roumanie patriarcale, avec ses boyards, ses lettrés, ses prêtres et ses paysans ; de l’autre, les étrangers et les parvenus sociaux d’origine non roumaine, qui ne vivent que pour satisfaire leurs intérêts et leurs pulsions.
Dans l’orbite de cette vision samanatoriste, d’abord circonscrite à la littérature, naît un roman, de la plume de Bucura Dumbrava,Haiducul (L’Haiduc). Dumbrava y décrit une société déterminée par des conflits qui ne sont pas de nature sociale mais ethnique. Les Phanariotes grecs ont pu régner sur les Valaques et les Moldaves parce que l’élite nationale était désunie. Précisément parce qu’elle était étrangère, la domination des Phanariotes était arbitraire. L’idéal de Dumbrava est le Prince Vlad Tepes (1448-1476), souverain implacable mais national.
Dans son roman, les bandes de brigands que sont les Haiducs (ou haïdoucs, bandits d’honneur), représentent le renouveau national. Ils se placent délibérément en dehors des lois, pour faire triompher le véritable droit national, oblitéré par les dominants étrangers. Les paysans considèrent les Haiducs comme leurs protecteurs et leurs sauveurs ; ils les nourrissent et les cachent comme des partisans. À l’intérieur des bandes, les membres sont liés par serment et se placent sous l’autorité d’un chef aux qualités exceptionnelles, le Capitan. Trahir le Capitan implique non seulement une entorse aux règles du groupe mais est un crime contre l’ensemble du peuple roumain et mérite, de ce fait, la mort.
Dans ce roman, lu par des quantités d’adolescents roumains, se retrouvent l’éthique nationale et l’esprit de corps de la Garde de Fer, expression d’un nationalisme nouveau par rapport à celui, littéraire et idéologique, des Eminescu, Iorga et Cuza, fondateurs du Parti National-Démocrate. À l’intérieur de ce parti, dans les années 20, nous trouvons une aile radicale, dirigée par Corneliu Sumuleanu et Ion Zelea-Codreanu. De cette aile radicale naîtra, après une rupture survenue quelques années plus tard, la Légion de l’Archange Michel.
(Nous donnons ici une vision assez incomplète du livre d’A. Heinen ; les chapitres sur l’évolution des doctrines nationalistes en dehors de la Légion et de la Garde sont importants eux aussi ; notamment, quand il évoque, dans l’œuvre de Mihail Maïnolesco, le passage du néo-libéralisme technocratique roumain à la doctrine du parti unique et du corporatisme moderne. Maïnolesco a eu une influence très importante en Allemagne, en Italie, dans la France de Vichy et dans la Politieke Akademie de Victor Leemans à Louvain en Flandre. Maïnolesco a donné une dimension européenne à l’idéologie roumaine. Nous y reviendrons).
► Robert Steuckers, Orientations n°13, 1991.
♦ Pour prolonger : « La Roumanie à la croisée des chemins », entretien avec B. Radulescu (in éléments n°90, 1997).
Carol II, roi de Roumanie
Point de Vue /Images du Monde est un magazine à succès. Depuis plus de 30 ans, il propose chaque semaine un vaste tour des têtes couronnées d’Europe et d’ailleurs. Une occasion unique pour ses 500.000 lecteurs de pleurer ou de rire aux petits aléas de la vie de leur princesse favorite. Un tel succès de presse n’a pas manqué de faire des jaloux, chacun rêvant d’acquérir une part du pactole né de cet engouement pour nos monarques. Il faut croire que les éditions Denoël sont à compter parmi ses envieux. Comment expliquer autrement la publication de la biographie de Carol II concoctée par son descendant le prince Paul de Hohenzollern-Roumanie.
Le texte tient en effet des chroniques insipides que consacre Point de Vue au chapeau de la reine mère d’Angleterre ou aux couches du dernier rejeton Grimaldi. Rien ne nous est épargné, de la décoration de sa chambre de jeune officier à l’école à Postdam en 1913 jusqu’à ses amours tumultueuses avec sa première femme, Ionna Marie Valentine Lupasco ou sa dernière maîtresse, Magda Lupescu. Il convient également de ne pas omettre les multiples pages consacrées à la nomenclature de sa collection de timbres qui fut, malheureusement pour le lecteur, la passion de toute sa vie.
Encore Point de Vue propose t-il de ravissantes photos où l’on peut observer en contre-jour les jambes de Lady Di, ce que Denoël a remplacé par 3 sombres in-quarto de Carol en uniforme. Notre journal préféré sur les Altesses a encore l’immense qualité d’être écrit en français et non traduit de l’anglais comme l’ouvrage du prince Paul, les gribouilles de son éditeur ayant choisi d’adapter la langue de Shakespeare en un sabir prétendument hexagonal.
Après tout peu importe, cette trahison des traducteurs a le mérite d’atténuer la sottise des analyses de Paul de Hohenzollern. Ce petit-fils illégitime du roi Carol manque en effet un peu de jugeote. Il qualifie ainsi la Garde de Fer de Codreanu de bande armée au service des nazis, décrit le successeur du Capitaine, Horia Sima, comme un personnage torve ou bien réduit le général Antonescu (dont on sait l’influence qu’il exerça sur des Roumains aussi célèbres en ces bords de Seine que Cioran, Ionesco, Vintilia Horia ou Virgil Georghiu) au rôle de marionnette de Hitler.
Une étude politique sans finesse
Difficile en fait d’attendre une fine étude politique d’un ouvrage qui exécute en 2 lignes la prise de pouvoir dictatorial de Carol en février 1938 et consacre plusieurs pages à sa liaison avec la femme d’un chef de gare (pages qui n’ont rien à voir, bien sûr, par leur style, avec l’épisode quelque peu similaire que l’on trouve sous la plume impériale de Joseph Roth dans La Marche de Radetzky).
Les erreurs de Paul de Roumanie sont d’autant plus patentes que la vie du roi Carol, qui s’est déroulée à l’ombre d’une histoire riche en événements, ne pouvait que lui fournir matière à de pertinents développements. Carol vécu en effet à une époque charnière pour la Roumanie. Né le 15 octobre 1893, il fait ses premiers pas dans les Carpates, derrière les murs de l’extraordinaire château de Peles, au cœur de ce qui n’est encore qu’un tout petit pays, héritier des volontés d’indépendance de 2 anciennes provinces turques, la Moldavie et la Valachie, qui avaient secoué en 1859 le joug ottoman.
La Première Guerre mondiale devait bouleverser totalement le paysage roumain. Le choix fait le 17 août 1916, par un accord secret, d’appuyer les forces de l’Entente apporta la ruine des armées roumaines attaquées par les troupes invincibles du Reich, commandées par von Falkenhayn. Paradoxalement cet échec immédiat fut largement compensé à la victoire par le traité de Versailles qui offrit à Bucarest de vastes territoires lui permettant de doubler sa superficie et le nombre de ses habitants.
Mais la Roumanie connut également au cours de la vie de Carol des changements politiques radicaux. Avant 1914, elle n’était qu’une nation de 12 millions d’habitants où la paysannerie était absolument prépondérante et le pouvoir exercé par la très allemande dynastie des Hohenzollern-Sigmaringen. Ces princes prussiens avaient été appelé en 1866 pour régner sur une Roumanie qui se cherchait un arbitre.
Promotion de la culture et style autoritaire
Autant le père et le grand-père de Carol II, Ferdinand et Carol Ier, étaient distants de leur peuple et de ses véritables aspirations, autant lui-même s’identifia totalement avec son pays et n’hésita pas une fois, parvenu au pouvoir en 1930, à multiplier les initiatives pour développer et faire connaître l’identité roumaine (1933, Fondation pour la littérature et les Beaux-Arts). Son action devait être saluée en termes particulièrement élogieux par le compositeur et patriote Georges Enesco, auteur des célèbres rhapsodies roumaines pour orchestre.
Plus tard, le roi ira jusqu’à imiter les modèles nationalistes en vogue alors en Europe, du Portugal de Salazar à la Grèce de Ioannis Metaxas, et créera un office d’éducation de la jeunesse roumaine la Straja Tzarii (Garde de la Patrie). Poursuivant dans cette voie, il s’arroge en 1938 les pleins pouvoirs et fonde le 15 décembre de cette année-là le Front de la Résistance nationale, le FRN, pâle copie des fascismes et qui ne pourra lui éviter d’abdiquer pour la deuxième fois en 1940, devant les changements géopolitiques internationaux qu’impose la montée en puissance de l’Allemagne, au profit de son fils Michel. Exilé, il mourra à 59 ans à Estoril au Portugal.
Jupons et Garde de Fer
De son parcours de prince, on peut finalement tirer quelques sommaires conclusions que Paul de Roumanie n’a même pas eu le talent d’esquisser. “Chercher la femme” aurait pu ainsi être la devise de son règne. C’est pour un amour effréné du doux sexe qu’il fut contraint d’abdiquer le 4 janvier 1926, c’est toujours pour la même raison qu’il avait failli en 1918 à son devoir de prince héritier. Tout ceci n’aurait pas porter à conséquence s’il n’avait doubler son intérêt pour les jupons de graves fautes de jugement politique. On ne peut être en effet que perplexe face à la lutte qu’il entame à partir de septembre 1936 contre la Garde de Fer. Affrontement vraiment fratricide que celui qui oppose un roi amoureux de son pays à Codreanu, chef visionnaire de la Légion de l’archange Saint-Michel (la Garde de Fer n’en est que l’un des aspects) qui proclamait « une nation vit pour l’éternité par les concepts qu’elle a choisis, par son honneur et par sa culture ».
Carol II qui a, dès la Première Guerre mondiale, manifesté son souci de la grandeur roumaine aurait dû être particulièrement sensible au discours de Codreanu, promoteur d’un mouvement absolument original dont le but premier et la raison d’être étaient le redressement spirituel et moral de l’homme, la création d’un homme nouveau, en rupture avec une certaine déliquescence moderne. Le roi pourtant manifeste très tôt son hostilité à la Légion de l’Archange Saint-Michel dont l’ascétisme (800.000 militants pratiquaient 3 jours par semaine l’abstinence de toute sorte de nourriture, boisson et tabac) est un défi à son propre amour du gain qui a fait de lui le plus grand capitaliste de Roumanie.
Carol II sait également que Codreanu constitue par son charisme (s’exerçant notamment sur la paysannerie) et sa figure originale, à la fois spirituelle et politique, la seule force d’avenir pour la Roumanie, la Légion, formée d’hommes presque tous jeunes, animés d’une foi invincible et liés entre eux par une discipline absolue, étant le glaive de ce chef s’élevant « du plan des contingences pour ramener à des prémisses authentiquement spirituelles une volonté de renouveau politico-national » (Julius Evola). Loin de savoir composer avec Codreanu, au nom de l’intérêt supérieur de la nation, Carol n’a de cesse de le considérer comme un rival. S’appuyant sur un politicien véreux et tortueux, Calinesco, il fait arrêter le Capitaine ainsi que la plupart des cadres légionnaires. Le 30 novembre 1938, un communiqué laconique annonce que Codreanu, ainsi que 13 autres légionnaires appartenant aux instances dirigeantes du mouvement, ont été abattus par là police au cours d’une tentative d’évasion. Ces morts retomberont en une définitive malédiction politique sur Carol, contraint le 6 septembre 1940 à « transmettre le fardeau de la Couronne à son fils », Le prince Paul de Hohenzollern restant muet sur l’épisode, on l’a vu, fatidique, de la rencontre historique de Carol et de Codreanu, on peut se pencher sur l’excellent n°2 de la Revue d’Histoire du Nationalisme Révolutionnaire (reprise en grande partie de textes de la Revue d’Histoire du Fascisme qu’animait François Duprat), consacré à la Garde de Fer. Les informations qui y sont données éclairent d’un jour nouveau cette pâle biographie de Carol et peuvent peut-être susciter un engouement dans le public hexagonal pour une Roumanie des années d’avant 1945 qui était largement tournée vers la France. Si Carol préférait la Suisse et ses palaces, on n’oubliera pas que c’est près de Grenoble, à Uriage, que Codreanu aimait à se ressourcer.
► Hugues Rondeau, Orientations n°13, 1991.
• Carol II, roi de Roumanie, par le Prince Paul de Hohenzollern, Denoël, 347 p.
• Revue d’Histoire du Nationalisme Révolutionnaire, Ars Magna, Nantes. [rééd. 2009, 11 €]
◘ Ion Antonescu, Maréchal et Conducator
Quelques jours après le deuxième arbitrage de Vienne (30 août 1940), qui règlait les contentieux entre la Hongrie et la Roumanie sous la houlette de von Ribbentrop, des troubles éclatent à Bucarest. En effet, les Roumains sont consternés : sans qu’un seul coup de fusil n’ait été tiré, la Bessarabie, le Nord de la Boukovine et la moitié de la Transylvanie ont été perdus et on s’attend à la perte du Sud de la Dobroudja. La Grande Roumanie de 1918, voulue par les Français à Versailles, s’est tout bonnement effritée. La colère du peuple se tourne d’abord contre le roi et contre sa maîtresse, Madame Lupescu. Le roi ne sait quelle décision prendre. Le conseil de la Couronne se réunit en permanence. C’est alors qu’un général se présente au Château royal : il s’appelle Ion Antonescu. L’officier vient d’un cloître éloigné de Bistritza, où le souverain l’a fait interner. La résidence royale devient subitement le lieu d’un affrontement. Antonescu évoque l’état d’esprit qui règne au sein du peuple et des forces armées et force le roi à se contenter d’un rôle purement représentatif. Le monarque appelle alors le commandant de sa garde. Il lui pose la question : ses soldats sont-ils prêts à tirer sur les manifestants ? Le commandeur des prétoriens roumains répond par la négative.
Carol II ne voit dès lors pas d’autre issue : sur l’heure, en ce 4 septembre 1940, il nomme Antonescu Premier Ministre. Après avoir reçu la promesse de pouvoir quitter le pays sain et sauf, le roi abdique, s’en va au Portugal, pays généralement choisi par beaucoup d’exilés à l’époque. Son successeur est son fils Mihail, qui cède au nouvel homme fort de la Roumanie bon nombre de ses prérogatives royales : il n’en gardera que 5.
Qui est donc cet homme qui veut sortir son pays de la crise, d’une main de fer? Ion Antonescu est le fils d’une ancienne famille d’officiers. Il est né le 15 juin 1882 à Pitesti en Valachie, dans le pays vallonné, semi-montagneux, qui annonce les Carpathes du Sud. Avec le grade de major, il s’était distingué pendant la première guerre mondiale. Après la Grande Guerre, par des coups de hussard, il lutte victorieusement contre la république communiste des Conseils hongrois, ce qui lui vaut un avancement rapide. Sous le règne de Carol II, en 1933, il accède au poste de chef d’état-major. Antonescu se jette avec fougue dans sa nouvelle mission mais ses projets déplaisent au monarque. Antonescu démissionne au bout d’un an. En 1937, il assume brièvement la charge de ministre de la défense. Ce poste de ministre n’est qu’une fausse promotion car le général n’est guère apprécié du roi et de la camarilla de la cour : il a des manières trop ouvertes, un style direct et surtout il mène une vie d’ascète. Pour les gens simples, Antonescu incarne le contraire diamétral de ce que représente à leurs yeux la caste dominante roumaine de Bucarest, francophile et aux mœurs dépravées, dont le symbole était le roi Ferdinand, plus tard Carol, alcoolique notoire. Les cercles dominants du “Paris de l’Est” se complaisaient dans le clinquant d’une “victoire” fictive lors de la première guerre mondiale. Le gouvernement avait fait édifier un arc de triomphe dans la capitale.
Après cette parenthèse, le nouveau chef d’État (le “Conducatorul al Statului”) se met énergiquement au travail. Un jour seulement après son entrée en fonction, les négociateurs roumains signent le Traité de Craiova qui sanctionne la rétrocession de la Dobroudja méridionale à la Bulgarie. En échange, les Roumains obtiennent ce qu’ils voulaient par ailleurs : que Berlin et Rome garantissent l’intangibilité de leurs nouvelles frontières. Sur le plan de la politique intérieure, Antonescu innove également. Il appelle plusieurs représentants de la fameuse Garde de Fer dans les cabinets ministériels. Le chef des gardistes roumains, Horia Sima, devient son représentant, son substitut. Le nouveau gouvernement demande à Berlin une aide substantielle pour réorganiser l’armée roumaine. Les Allemands ne se le font pas demander 2 fois car ils songent surtout au pétrole de Ploesti. Le 15 septembre, le Général Kurt von Tippelskirch arrive à Bucarest. Des troupes composées d’instructeurs le suivent très rapidement : en tout, 20.000 hommes. Le calcul d’Antonescu est clair : il veut récupérer les régions perdues, en montrant une loyauté exemplaire à l’égard d’Adolf Hitler. À la fin du mois d’octobre 1940, les Soviétiques occupent 3 îles dans le delta du Danube, acte qui soude littéralement Bucarest à Berlin. La réponse à la provocation soviétique est simple : la Roumanie adhère immédiatement au Pacte des Trois Puissances (ou l’Axe Berlin-Rome-Tokyo).
À la fin du mois de mai 1941, les troupes allemands commencent à se déployer le long de la Moldava, où, dans le cadre d’une mobilisation cachée, stationnent déjà 15 divisions roumaines. Au début de l’Opération Barbarossa, 200.000 soldats de l’infanterie allemande se trouvent sur le sol roumain. Le 12 juin 1941, Antonescu rencontre Hitler. Celui-ci l’informe de l’imminence de la guerre à l’Est. Le Chancelier du Reich est séduit par ce général aux arguments clairs, aux discours sans fioritures inutiles et lui offre aussitôt le commandement de toutes les unités de l’aile droite du futur front de l’Est. Ce “Groupe d’armées Antonescu” comprend la 11ème Armée allemande et les 3ème et 4ème armées roumaines. Le matin du 22 juin fatidique, Antonescu part immédiatement pour le front, dans un train spécial. Les Roumains étaient déjà en train de consolider des têtes de pont sur la rive orientale du Prouth. Le 26 juin, des appareils soviétiques bombardent Bucarest, la zone pétrolifère de Ploesti et le port de Constanza sur la Mer Noire.
Le Conducator devint rapidement le terreur des états-majors. Il harangue ses troupes, veille à ce qu’elles soient parfaitement approvisionnées. Les soldats l’adorent : sans peur, le Général vient leur rendre visite sous le feu de l’ennemi dans les tranchées les plus exposées du front. Au départ, le “Groupe d’armées Antonescu” avait reçu pour mission de protéger la Roumanie contre toute attaque soviétique vers le Danube. Mais au bout d’une semaine, ce groupe d’armées s’élance à l’attaque, avec succès car, le 26 juillet, il prend la ville d’Akkerman (ou, en roumain, “Getatea-Alba”) sur le cours inférieur du Dniestr, qui redevient roumaine, comme toute la Bessarabie et le Nord de la Boukovine. La population acclame les troupes roumaines libératrices. Le 6 août 1941, Antonescu est le premier étranger à recevoir la Croix allemande de Chevalier ; 2 semaines plus tard, le roi le nomme Maréchal de Roumanie. Après avoir atteint le fleuve-frontière qu’est le Dniestr, Antonescu renonce à ses fonctions de commandant de groupe d’armées et retourne à Bucarest. Beaucoup pensent qu’avec la reconquête de la Bessarabie, que Moscou avait obtenue en faisant pression sur la Roumanie, la guerre est finie. Le jeune roi Mihail déclare : “Nous devons rester sur le Dniestr. Entrer en Russie signifierait agir à l’encontre de la volonté du pays”. Mais personne ne l’écoute.
Antonescu prend alors une décision qui sera lourde de conséquence : il croit aux vertus de la Blitzkrieg, de la guerre-éclair, et fait marcher les troupes roumaines dans la région qui s’étend immédiatement au-delà de la rive orientale du Dniestr. Les Roumains l’annexent sous le nom de Transnistrie. Lors de la prise d’Odessa, les difficultés surviennent : la ville ne capitule qu’au bout de deux mois et les Roumains ont dû faire appel à l’aide allemande. En décembre 1941, le Reich demande à ses alliés de participer plus activement à la consolidation du front oriental. Antonescu, sans broncher, renforce ses contingents, dans l’idée de récupérer bientôt le nord de la Transylvanie, devenu hongrois. 26 divisions de l’armée royale roumaine garnissent désormais le flanc sud du front de l’Est. Vers la fin de l’année 1942, la fortune des armes change de camp. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques amorcent une grande offensive vers le Don, ce qui conduit à l’effondrement de la 3ème armée roumaine. En même temps, l’Armée Rouge annihile la 4ème armée dans la steppe des Kalmoucks.
Au début de l’année 1943, le Maréchal Antonescu est pris entre 2 feux. Les pertes énormes en hommes font que le roi se met à douter de son Premier Ministre. Par ailleurs, lors d’une rencontre, Hitler le morigène cruellement. Dans une atmosphère de glace, où la conversation est menée debout, l’Allemand le rend responsable du désastre sur le Don et à Stalingrad. Au printemps, Antonescu envoie des négociateurs pour traiter avec les alliés occidentaux. À la mi-mai, ces négociations sont rompues parce que les conditions imposées par les Anglo-Américains sont trop dures. Nolens volens, Antonescu est contraint de poursuivre le combat dans le camp de l’Axe. 9 mois plus tard, les troupes soviétiques s’approchent des frontières roumaines. Dans le royaume, on décrète la mobilisation générale. Le “Groupe d’Armées d’Ukraine méridionale”, commandé par le Colonel-Général Hans Friessner compte à l’été 1944 un million de soldats.
Le 20 août, les feux de l’enfer se déchaînent. Après une préparation d’artillerie qui a duré des heures, où les Soviétiques lancent des milliers et des milliers de fusées “Katiouchka”, les blindés de Staline se taillent une brèche dans le front. Deux jours après, Antonescu se présente chez Freissner, qui commence par lui servir un bon verre de vin, avant de lui annoncer que l’effondrement menace, est imminent. Le roi, à son tour, passe à l’action, et ordonne au Prince Stirbey, chef de la délégation roumaine qui négocie au Caire, d’accepter les conditions draconiennes imposées par les Alliés pour un armistice. C’est alors que se répèta un scénario sembable à celui qui eut lieu à Rome un an plus tôt : le souverain convoque Antonescu au palais l’après-midi du 23 août ; lors de l’audience, des officiers affidés au roi s’emparent de la personne du Maréchal.
Le nouveau Premier Ministre est le Colonel-Général Constantin Sanatescu. À 22 heures, à la fin de cette journée de tumultes, les Roumains entendent la voix de leur roi à la radio : “la dictature a pris fin et ainsi toute forme d’oppression”. Le gouvernement Sanatescu rompt le lendemain toutes les relations avec Berlin et déclare la guerre à l’Allemagne le 25 août.
Ion Antonescu et ses plus proches collaborateurs sont alors aux mains des communistes roumains, actifs dans la clandestinité ; ils livrent leurs prisonniers aux Soviétiques. Après deux ans d’emprisonnement en Union Soviétique, l’ancien Premier Ministre roumain revient à Bucarest. Un procès pour crimes de guerre s’organise, qui se termine par une sentence de mort comme l’avaient exigé les Soviétiques. Tôt le matin du 1er juillet, on amena le Maréchal dans la cour de la prison militaire de Bucarest-Jilava. Ce furent les dernières minutes de la vie de Ion Antonescu.
► Erich Körner-Lakatos (Zur Zeit n°32/2006, Vienne ; tr. fr. : RS).
◘ Mircea Eliade et la Garde de Fer
• Analyse : Claudio Mutti, Mircea Eliade e la Guardia di Ferro, Ed. All’Insegna del Veltro, Parma, 1989, 57 p.
[◘ Trad. fr. : • Mircea Eliade et la Garde de Fer, chez Ars Magna, Nantes, 2005 ; cf. aussi Les Plumes de l’archange, Quatre intellectuels roumains face à la Garde de Fer : Nae Ionescu – Mircea Eliade – Emil Cioran – Constantin Noica, éd. Hérode, coll. Les Deux Etendards, 1993, 144 p.]
Au-delà des mythes de signes contraires qui circulent sur la Garde de Fer, au-delà des apologies ou des démonisations, on peut affirmer que le mouvement de Codreanu était profondément lié à la culture et à l’âme de la Roumanie ; tentant de se mettre au diapason de cette culture et de cette âme, d’en épouser toute la complexité, cherchant à s’identifier à elles, le mouvement de Codreanu luttait pour faire sortir la nation roumaine de son état de décadence, de ces conditions d’existence jugées inférieures et propres aux pays balkaniques marqués par l’esprit levantin. La Roumanie était sujette aux influences extérieures les plus disparates, qui aliénaient ses racines les plus anciennes, niées purement et simplement par une certaine culture de tendance “illuministe” qui s’incrustait dans une société roumaine aux réflexes largement ruraux et intacts. L’action de la Garde de Fer, dans cette perspective, apparaît comme une entreprise titanesque, parfois velléitaire, vu la disproportion entre les forces en présence (les ennemis de la Garde de Fer détenaient le pouvoir absolu en Roumanie). Les légionnaires voulaient faire renaître leur peuple en très peu de temps, par le biais d’un activisme radical, portant sur de multiples niveaux : existentiel, éthique, spirituel, où la politique n’était, finalement, qu’un instrument de surface, utilisé par une stratégie d’une ampleur et d’une épaisseur bien plus vastes et profondes.
Dans les faits, la plupart des militants du mouvement s’exprimaient dans un style volontariste, entendaient témoigner de leur foi, faisaient montre d’un activisme fébrile, parfois aveuglément agressif : lumières et ombres se superposent inévitablement dans le phénomène légionnaire. Cependant, la force de ces militants profondément sincères a attiré la sympathie des intellectuels attachés à la patrie roumaine, à sa culture nationale et populaire, à sa substance ethnique ; parmi ces intellectuels : Mircea Eliade, un jeune chercheur, spécialisé dans l’histoire des religions et du folklore.
Stefan Viziru, est-il Mircea Eliade ?
Récemment, la publication posthume en français et en anglais d’une partie des journaux d’Eliade a jeté une lumière nouvelle sur cette période et sur l’attitude du grand historien des religions. Claudio Mutti a analysé ces journaux, offrant à ses lecteurs, condensées en peu de pages, de nombreuses informations inédites en Italie. Ce travail était nécessaire parce qu’en effet nous avons toujours été confrontés à une sorte de “trou noir” dans la vie d’Eliade, sciemment occulté par l’auteur du Traité d’histoire des religions. Mutti, pour sa part, croit discerner les indices d’un engagement dans l’un des romans d’Eliade, La forêt interdite, aux accents largement autobiographiques, qui se limite toutefois aux années 1936-1948.
Le protagoniste principal de l’intrigue du roman, Stefan Viziru, pourrait, d’après Mutti, dissimuler Eliade lui-même, mais sous un aspect qui, au premier abord, n’est pas du tout crédible. Viziru, en effet, se manifeste dans le roman comme un antifasciste démocratique, bien éloigné des positions de la Garde de Fer, mais qui est néanmoins arrêté pendant la répression anti-gardiste de 1938, parce qu’il a donné l’hospitalité à un légionnaire. Dans un tel contexte, Mutti estime très significatif le jugement exprimé par Viziru quand il s’adresse à un autre prisonnier de son camp d’internement : « Vous et votre mouvement accordez une trop grande importance à l’histoire, aux événements qui se passent autour de nous. La vie ne mériterait pas d’être vécue si, pour nous, hommes modernes, elle ne se réduisait exclusivement qu’à l’histoire que nous faisons nous-mêmes. L’histoire se déroule exclusivement dans le Temps, et, avec tout ce qu’il a de meilleur en lui, l’homme cherche à s’opposer au Temps […]. C’est pour cette raison que je préfère la démocratie, parce qu’elle est anti-historique, je veux dire par là qu’elle propose un idéal qui, dans une certaine mesure, est abstrait, qui s’oppose au moment de l’histoire ». Sous bien des aspects, nous retrouvons, dans ce jugement de Viziru, tout Eliade, avec son refus d’un devenir linéaire, absolu, quantitatif, totalisant.
Justement, Mutti nie que l’identification Viziru-Eliade puisse être poussée au-delà d’une certaine limite. Pour appréhender la position réelle d’Eliade vis-à-vis de la Garde de Fer — on a affirmé qu’il lui avait été totalement étranger — il faut lire le volume posthume de ses mémoires, concernant les années 1937-1960, où Eliade dément effectivement que le héros central de La forêt interdite est son alter ego, tout en donnant d’intéressantes précisions pour comprendre quelles furent ses positions politiques et idéologiques à l’époque. Eliade nous livre en outre d’intéressantes informations sur le climat qui règnait en Roumanie à la fin des années 30, au moment où le mouvement légionnaire connaissait un véritable triomphe. L’historien des religions nous décrit le sombre tableau des répressions gouvernementales contre la Garde de Fer : le roi et l’élite libérale-conservatrice au pouvoir cherchaient, par tous les moyens, à arrêter les progrès du mouvement légionnaire. Pour éviter toute provocation, Codreanu avait choisi la voie de la non-violence, mais le gouvernement, vu l’insuccès électoral des listes qui le soutenaient et vu l’augmentation continue du prestige légionnaire — comme l’écrit Eliade — opte pour le recours à la force : des milliers de membres de la Garde de Fer furent emprisonnés, à la suite de procédures d’une brutalité inouïe, qui semblent propres aux gouvernants roumains de toutes tendances, comme l’a prouvé encore l’histoire récente.
Mircea Eliade, assistant de Nae Ionescu
Pendant la répression de 1938, plusieurs intellectuels qui avaient adhéré au mouvement de Codreanu furent arrêtés, tandis que le Capitaine était assasiné, la même année, par des sicaires du régime. Parmi les intellectuels embastillés, il y avait Nae Ionescu, un professeur d’université célèbre, dont Eliade était l’assistant. À propos de cette arrestation, il écrit : « De manière directe ou indirecte, nous étions tous, nous ses disciples et collaborateurs, solidaires avec les conceptions et les choix politiques du professeur ». Cette « syntonie » a duré — même si Mario Bussagli a dissimulé une divergence de vue précoce entre les 2 hommes — car Eliade a prononcé le discours funèbre aux obsèques de son maître en 1940.
Au cours de la répression anti-gardiste, Eliade lui-même a été interné dans un camp de concentration, mais pour une période assez brève. Il refusa de signer une abjuration pré-rédigée du mouvement légionnaire, malgré les fortes pressions qui étaient exercées sur les prisonniers (et face auxquelles un certain nombre d’entre eux cédaient). Eliade affirme dans ses mémoires : « Je jugeai qu’il était inconcevable de me dissocier de ma génération en plein milieu de la terreur, quand on poursuivait et persécutait des innocents ». Une année auparavant, répondant à une question posée par le journal légionnaire Buna Vestire, Eliade avait déclaré : « Le monde entier se trouve aujourd’hui sous le signe de la révolution, mais, tandis que d’autres peuples vivent cette révolution au nom de la lutte des classes et du primat de l’économie (communisme) ou de l’État (fascisme) ou de la race (hitlérisme), le mouvement légionnaire est né sous le signe de l’Archange Michel et vaincra par la grâce divine […]. La révolution légionnaire a pour fin suprême la rédemption du peuple ». Dans cette phrase, transparait une adhésion au projet global de la Garde de Fer, qui n’est pas purement épidermique, de même qu’une mentalité bien différente de celle du personnage Stefan Viziru.
Après avoir consulté d’autres sources, Mutti soutient qu’Eliade a été candidat sur les listes électorales du parti de Codreanu et aurait été élu député peu avant la répression de 1938. Cette affirmation nous apparaît étrange, parce que si tel avait été le cas, si, effectivement, Eliade avait occupé un poste officiel et public, on l’aurait su depuis longtemps, sans même avoir eu besoin de recourir aux informations parues dans des publications jusqu’ici méconnues et rédigées par des légionnaires en exil, publications auxquelles Mutti pouvait accéder. Parmi les diverses mises au point présentées dans ce petit volume, signalons la partie visant à démontrer qu’Eliade était antisémite, ce qui est un mensonge et ne peut servir qu’aux détracteurs fanatiques de sa pensée. Toutes choses prises en considération, le travail de Mutti est équilibré quant au fond, en dépit de certains extraits qui idéalisent outrancièrement la Garde de Fer. Nous pouvons considérer que ce livre est une première contribution — qu’il s’agira d’approfondir — à l’étude d’un segment de la vie d’Eliade, tenue par lui-même dans l’ombre, pour des raisons somme toute bien compréhensibles. D’un segment de vie étroitement lié à l’une des plus tragiques périodes de l’histoire roumaine.
►Giovanni Monastra, Orientations n°13, 1991. (tr. fr. : RS)
♦ Sur ce sujet, on pourra aussi consulter : la 3ème partie de Mythologies du XXe siècle : Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade de D. Dubuisson, Septentrion, 2008 comme exemple, outre son autre réquisitoire, de déni d’apport d’Eliade à l’histoire des religions (alors que c’est pour sauvegarder les différents sens du sacré des peuples, patrimoine de plus en plus menacé, que celui-ci a investi cette discipline comme collecte descriptive exhaustive, à la manière des Frères Grimm avec la culture orale des contes) ; « Un mythe moderne, Mircea Eliade », P. Borgeaud in Exercices de mythologie, Labor & Fides, 2004 ; 4 lettres d’Eliade à Evola dans Dossiers H – Evola (L’Âge d’Homme). Voir aussi cet article en anglais de Guido Stucco, Eliade and Evola, et de C. Mutti traduit en roumain : “Capitanul si Italia“.
◘ LA GARDE DE FER REVISITÉE
- Claudio Mutti, Les plumes de l’Archange. Quatre intellectuels roumains face à la Garde de Fer : Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Éditions Hérode (14, place de la République, 71100 Chalon-sur-Saône), 1993, 143 p.
- Origini, numéro spécial consacré à EM Cioran, sous la dir. de C. Mutti, n°13, fév. 1996, 44 p. (c/o La Bottega del Fantastico, Via Plinio 32, 20129 Milano).
- Julius Evola, La tragedia della Guardia di Ferro, avant-propos de Gianfranco De Turris, préface de C. Mutti, Fondazione Julius Evola (c/o Libreria Europa Editrice, Via S. Veniero 74/76, 00192 Roma), 1996, 64 p.
Jusqu’à certains travaux, parus dans les années 70, du grand historien du fascisme Renzo De Felice, également auteur d’une monumentale biographie de Mussolini, la Légion de l’archange Michel, fondée le 24 juin 1927 par Corneliu Zelea Codreanu (1899-1938) et 4 de ses camarades, n’était étudiée que dans le cadre, tout à la fois vague, scientifiquement impropre et lesté de polémiques, de l’« Internationale des nationalismes (ou fascismes) » de l’entre-deux-guerres. Plus soucieux de dégager les traits propres du fascisme italien par rapport au national-socialisme que de subsumer ces 2 espèces dans le genre fourre-tout nommé “fascisme”, De Felice ouvrit la voir à une série de monographies pionnières étudiant cas par cas, pays par pays, les mouvements traditionalistes, contre-révolutionnaires, nationalistes, etc., au XXe siècle.
En 1980, l’un de ses élèves, Mario Ambri, rangeait la Garde de Fer — autre dénomination (la plus courante, en fait) de la Légion, la troisième étant celle de Mouvement légionnaire roumain —, parmi les « faux fascismes » (voir I falsi fascismi, Rome, 1980). Six ans plus tard, l’historiographie du phénomène légionnaire s’enrichissait d’un gros ouvrage d’un sérieux tout germanique, qui mettait notamment en relief le caractère atypique, relativement aux “fascismes”, de la base sociologique de la Garde : une espèce d’alliance des paysans et des intellectuels, pour ces derniers essentiellement des universitaires et des professions libérales, la petite et moyenne bourgeoisie brillant surtout par leur absence (voir Armin Heinen, Die Legion “Erzengel Michael” in Rumänien, Munich, 1986).
En Italie pourtant, certains n’avaient pas attendu De Felice pour s’intéresser à un phénomène jusque-là sommairement qualifié de « fascisme exotique » : les milieux traditionalistes formés au magistère de Julius Evola. Une brève biographie, Codreanu il Capitano (Rome, 1971) et une anthologie de textes sur le sujet, Codreanu e la Guardia di Ferro (Rome, 1977), dues toutes 2 à Carlo Sburlati, étaient venues prolonger le sillon de l’intérêt évolien pour la Garde. Il faut en effet savoir qu’Evola écrivit 6 articles sur la Garde de Fer : 5 en 1938 — dont 2 au lendemain de sa rencontre avec Codreanu à Bucarest en mars de cette même année, 3 postérieurs à l’assassinat du “Capitaine”, comme l’appelaient ses partisans, le 30 novembre 1938 — et un en 1973. Ce sont ces textes évoliens, dont certains avaient d’ailleurs déjà été exhumés, que la Fondation Julius Evola a réunis récemment, les faisant précéder d’une présentation substantielle et très documentée de Claudio Mutti sur le thème « Evola et la Roumanie ».
La France, sur le sujet qui nous occupe, fait figure de parent pauvre, ce qui ne s’explique pas facilement si l’on songe que notre pays fut, après 1945, la principale terre d’accueil, juste derrière l’Espagne franquiste, pour les milieux légionnaires de l’exil. Ceux-ci ont publié de nombreux travaux sur l’histoire, l’organisation et la doctrine de la Garde, mais dont la diffusion, en dehors de la diaspora roumaine, est toujours restée quasiment confidentielle. Il y eut tout de même une exception à la règle du manque d’intérêt français pour la Légion de l’archange Michel : un gros numéro spécial (240 pages) de la revue Totalité, paru en 1984.
Ce vide historiographique a été comblé, en partie du moins, par un petit livre très dense, littéralement bourré de notes et de références : Les plumes de l’Archange. Il est vrai que son auteur sait de quoi il parle : Mutti, qui lit couramment le roumain, a traduit et présenté de nombreux textes légionnaires et s’est rendu à plusieurs reprises en Roumanie, notamment après la chute du régime de Ceausescu en décembre 1989, pour y rencontrer quelques derniers témoins et y consulter des archives. Consacré à 4 intellectuels qui furent membres ou sympathisants de la Garde, son étude déborde forcément le cas de chacun et fournit une information abondante sur le phénomène légionnaire. Elle est d’ailleurs précédée d’une longue introduction (pp. 7-35) du traducteur Philippe Baillet, qui se penche sur la doctrine de la Garde, et flanquée de dix pages de chronologie, sans oublier des compléments bibliographiques en fin d’ouvrage.
Il s’agit donc là d’un travail très sérieux dont le ton et le point de vue, en dépit d’une sympathie que l’on pourra juger trop marquée pour le phénomène considéré, ne versent jamais dans le parti-pris militant ou le plaidoyer. L’auteur « entend répondre tant aux imputations des accusateurs arrogants qu’aux pieux mensonges des apologistes intimidés, par la force de la vérité et le courage de la revendicatron doctrinale » (p. 56).
Mutti fait tout d’abord bien ressortir l’influence considérable qu’exerça Nae Ionescu (1890-1940) sur l’intellectualité roumaine des années 30. Intellectuel charismatique, à la fois philosophe, logicien, épistémologue et théologien laïc d’un christianisme ascétique, Ionescu, dont Eliade fut le disciple direct, rompit avec les cercles de la cour du roi Carol en 1933 et fut pour beaucoup, par le prestige et l’autorité dont il jouissait, dans l’adhésion de nombreux universitaires et étudiants à la Garde de Fer.
1933 fut également l’année de la “conversion” de Mircea Eliade (1907-1986), dont on sait qu’il fait l’objet en France, depuis quelques années, d’un procès posthume qui n’est pas sans rappeler ceux intentés à Heidegger et à Dumézil. L’un des mérites de Mutti est de prouver, références à l’appui, que le mauvais procès fait à Eliade est en réalité ancien, puisque dès 1949 l’auteur roumain avait été dénoncé en Italie, dans le cadre d’une tentative visant à bloquer la parution de certains de ses livres chez le grand éditeur turinois Einaudi, comme un « scélérat roumain en exil », un « agitateur fasciste ». Mauvais procès, avons-nous dit : car Mutti démontre, en citant de nombreux écrits éliadiens des années 30, qu’Eliade non seulement ne partageait pas « l’antisémitisme théologique » de son maître Ionescu — lequel en arrivait à soutenir que, depuis le Golgotha, le salut est interdit aux juifs —, mais que, par rapport à la question juive et dans un pays où l’antisémitisme pouvait se prévaloir du prestige d’auteurs nationaux fameux (à commencer par le plus célèbre d’entre eux, le poète Eminescu), Eliade faisait preuve d’une pondération certaine. Alors qu’il est déjà pleinement engagé aux côtés de la Garde, Eliade, en 1936, défend l’œuvre du grand folkloriste et ethnographe juif Moses Gaster, spécialiste des traditions populaires roumaines, et fait de même trois ans plus tard, à l’occasion de la mort du savant.
Relancé au moment de la mort à Paris d’Emil Cioran (né en 1911) le 20 juin 1995, le procès d’Eliade, accusé en outre d’avoir défendu dans ses travaux d’histoire des religions une « ontologie (ou : une métaphysique) antisémite » (Daniel Dubuisson), a donné lieu à des jugements de ce genre : « … Mircea Eliade n’a pas trouvé le courage intellectuel d’une confession lucide quant à son passé et ses orientations politiques d’extrême droite. En revanche, Emil Cioran, lui, aussi bien dans ses écrits que dans ses entretiens privés, a toujours condamné la folie meurtrière des hommes qui avait abouti aux horreurs que l’on sait » (Edgar Reichmann, « Les égarements et les remords d’un intellectuel », in Le Monde, 22 juin 1995).
La réalité, en fait, est sensiblement différente : si Eliade est aujourd’hui vilipendé, réputé infréquentable pour avoir développé une “ontologie antisémite” dont personne dans la communauté scientifique mondiale n’avait cependant décelé l’existence sur un demi-siècle, tandis que Cioran est porté aux nues par les esthètes du parisianisme fin de siècle, c’est parce que le premier a refusé de se renier de la façon “politiquement correcte” qu’on exigeait de lui. Tout en dénonçant les crimes de la Garde de Fer, Eliade, dans ses Mémoires, n’a pas craint du rappeler nettement la répression féroce et sanglante qu’elle eut à affronter, d’insister sur l’idéalisme de Codreanu et les pratiques ascétiques des cadres légionnaires. Cioran, lui, avait pris soin depuis longtemps de se plier à certains diktats : c’est ainsi que, dès 1970, dans un entretien paru à Vienne et repris en 1995 dans la collection “Arcades” chez Gallimard, il déclarait avec hauteur et élégance : « … la Garde de Fer était un complexe de mouvements et plutôt une secte délirante qu’un parti. (…) La Garde de Fer passait pour une espèce de remède à tous les maux, y compris l’ennui, et même la chaude-pisse ».
Dans les années 30 et jusqu’en 1941 au moins, Cioran, simple sympathisant de la Garde et non adhérent comme Eliade, fait preuve d’un fanatisme, en matière d’antisémitisme par ex., qu’on cherche en vain chez ce dernier. De ce point de vue également, le livre de Mutti apporte un éclairage utile, à commencer par des citations de La transfiguration de la Roumanie, ouvrage de Cioran paru à Bucarest en 1937, réédité en 1941 et 1990, mais qui ne figure pas dans les Œuvres publiées par Gallimard en avril 1995, alors qu’on y trouve tous les autres livres de la période roumaine de Cioran. Depuis la parution des Plumes de l’Archange, Mutti a complété l’information dont on disposait en traduisant pour la revue Origini certains articles de Cioran remontant à l’époque dont nous parlons.
Le 15 juillet 1934 paraît dans le joumal Vremea un article de Cioran intitulé « Impressions de Munich », où l’on peut lire notamment : « Dans le monde d’aujourd’hui, il n’y a pas d’homme politique qui m’inspire autant de sympathie et d’admiration que Hitler. Il y a quelque chose d’irrésistible dans le destin de cet homme, pour lequel chaque acte de la vie n’acquiert un sens qu’à travers la participation symbolique au destin historique d’une nation ». Le 25 décembre 1940, un article de Cioran intitulé « Profilul interior al Capitanului » (Le profil intérieur du Capitaine) est lu à la radio d’État de l’éphémère “État national-légionnaire” proclamé le 14 septembre 1940, dans le gouvernement duquel la Garde est en charge de rien moins que neuf ministères. L’article paraît simultanément dans le joumal Glasul Stramosesc. On y lit cette évocation de Codreanu : « Il a insufflé l’honneur à une nation d’esclaves ; il a redonné le sens de l’orgueil à un troupeau invertébré. (…) La foi d’un homme a donné naissance à un monde qui laisse derrière soi la tragédie antique et Shakespeare. Et ce dans les Balkans ! (…) À partir de maintenant le pays sera guidé par un mort, me disait un ami sur les rives de la Seine. Ce mort a répandu un parfum d’éternité sur notre menu fretin humain et a ramené le ciel au-dessus de la Roumanie ».
Par comparaison avec des personnalités aussi fortes que Ionescu, Eliade et Cioran, la figure du philosophe Constantin Noica (1909-1987), qui se rallia à la Garde tardivement, en signe de protestation contre l’assassinat de Codreanu, paraît un peu terne. L’importance de sa vocation socratique ne saurait cependant être sous-estimée : c’est en effet parmi les élèves de Noica, qu’il forma à partir de l’année 1975 à Paltinis, dans sa retraite de Transylvanie, que se recrutent quelques-uns des intellectuels roumains les plus représentatifs aujourd’hui, dont Gabriel Liiceanu, directeur des éditions Humanitas depuis 1990 et auteur d’un essai sur Cioran qui a été traduit en français (voir Itinéraires d’une vie : EM Cioran, Michalon, Paris, 1995).
En dehors des travaux d’un membre du Mouvement légionnaire en France, Faust Brădesco, travaux qu’il n’est pas facile de se procurer, et du numéro de Totalité déjà mentionné, le public français ne disposait que d’éléments très minces pour se faire une idée de la doctrine de la Garde de Fer. Dans son introduction à l’étude de Mutti, Philippe Baillet s’est précisément attaché à remédier à cette situation, avec pour objectif principal de démontrer que les éléments réputés « fascistes et nazis » sont périphériques dans la doctrine légionnaire et que ce qui y est central, c’est le christianisme orthodoxe doublé d’un grand mythe archaïque — la construction spirituelle qui ne périra pas grâce au sacrifice de ses fondateurs —, lui-même christianisé.
La Garde, d’ailleurs, ne revendiquait pas une quelconque originalité doctrinale, mais bien plutôt une doctrine originelle. Dès le début de son histoire, le religieux y prime sur le politique, du moins dans le discours énonciatif, la « déclaration d’identité ». Ainsi, l’un des fondateurs du Mouvement, Ion Moţa, fils d’un pope, écrit en 1927 dans le premier numéro de l’organe officiel de la Légion : « Nous ne faisons pas, ni n’avons fait un seul jour de notre vie, de la politique… Nous avons une religion, nous sommes les serviteurs d’une foi ». Codreanu, lui, définit la Garde, dans le manuel des instructeurs légionnaires, comme une « école spirituelle ». En 1977 encore, Horia Sima, désigné pour lui succéder le 6 septembre 1940, tenait ces propos étonnants pour le “chef politique fasciste” qu’il était censé avoir été : « Le christianisme est une question de vie intérieure et non de syllogismes. Nous sommes chrétiens uniquement dans la mesure où nous identifions notre existence à l’amour. (…) C’est le mystère ultime et le plus impénétrable de l’existence. Nous ne connaissons que la manifestation concrète, visible, de l’amour, qui est le sacrifice ».
[ci-dessus : couverture du n°8 de Pămîntul Strămoşesc, édité à Iasi (Moldavie) en 1927]
Pour Ph. Baillet, l’erreur de tous ceux qui ont parlé, à propos de la Garde, de « mystique de la mort » ou de « dolorisme obsessionnel » — interprétant sa doctrine comme la simple extrémisation d’une nécrophilie réputée typique des “fascismes” indistinctement — tient à leur ignorance totale de ce que Mircea Eliade appelait en 1936-37, dans ses Commentaires sur la Légende de maître Manole (cet ouvrage, qui ne parut à Bucarest qu’en 1943, a été traduit en français : L’Herne, Paris, 1994), le « mythe central de la spiritualité du peuple roumain » : à savoir celui de l’immolation volontaire de l’épouse du maître d’ouvrage Manole, seule manière d’assurer la pérennité dans les siècles du monastère d’Arges. En effet, ce sont bien ces nombreux renvois explicites, conscients, délibérés au mythe de la femme cachée dans la pierre – symbole de l’éclipse ou occultation de la Tradition – et à son sacrifice nécessaire, qui font la spécificité de la doctrine légionnaire. Codreanu écrit dans son manuel : « Le légionnaire aime la mort, car son sang servira à cimenter la Roumanie légionnaire ». Chez son ami Ion Mota, le mythe fait carrément et clairement irruption dans la conscience : « Notre action est une pierre angulaire de cette nouvelle construction légionnaire roumaine qui — suivant la volonté du destin, laquelle a été ainsi dès les temps légendaires de maître Manole — a exigé notre ensevelissement dans les fondations que, dès lors, les siècles ne pourront plus démolir » écrit Mota le 3 décembre 1936, jour de son départ pour l’Espagne, où il sera tué le 13 janvier suivant dans les rangs du soulèvement nationaliste.
À la différence du fascisme italien, du national-socialisme allemand et même de la Phalange espagnole, à laquelle on l’a souvent comparée en raison de leurs communes racines chrétiennes, la Garde de Fer ne semble pas instrumentaliser le mythe à des fins politiques précises, mais le réactualiser véritablement, dans le cadre d’une de ses épiphanies authentiques et spontanées. Certes, comme le souligne Ph. Baillet, une marge d’incertitude subsiste, car il est sans doute impossible de faire le départ, pour un phénomène surgi en plein XXe siècle, entre le retour de la Tradition et le recours à la Tradition. Les éléments fournis par Ph. Baillet sur la pratique militante de la Garde – les services religieux précédant ses réunions, sa façon de s’organiser en “contre-société”, les épreuves imposées au néophyte qui reproduisaient un véritable schéma initiatique, et même la valeur toute spéciale attribuée au nombre 13 – viennent en tout cas confirmer, s’il en était encore besoin, la singularité et la radicalité du phénomène légionnaire, indissociable des traditions populaires roumaines et du christianisme orthodoxe.
Par ailleurs, les traditions roumaines furent au cœur des préoccupations du principal correspondant de R. Guénon dans les Balkans, Vasile Lovinescu (1905-1984), sur lequel on trouvera des informations inédites dans Les plumes de l’Archange (pp. 133-138). Auteur, sous le pseudonyme de Geticus, d’une série d’articles parus dans les Études Traditionnelles en 1936-37 (réédition : La Dacie hyperboréenne, Pardès, Puiseaux, 1987), Lovinescu découvrit l’œuvre d’Evola dès 1929. Selon toute probabilité, ce fut lui, avec Eliade, qui servit d’intermédiaire entre Evola et Codreanu pour la rencontre de mars 1938, car son frère, Horia, était membre du Mouvement légionnaire. La correspondance de Guénon avec Lovinescu couvre les années 1934-1939. Sur le conseil de Guénon, Geticus se rendit à Amiens en 1936 pour y rencontrer Frithjof Schuon. Lovinescu retrouva Michel Vâlsan à Paris en 1939 et, rattaché depuis 1936 à la tarîqah alawwiyah, devint après la guerre muqqadim pour la Roumanie et les Balkans, comme l’a récemment établi Claudio Mutti (voir son article « Vasile Lovinescu e il suo ambiente », in Heliodromos (Catane), 9, hiver 1995, pp. 17-25). Le premier livre de Lovinescu parut fort tardivement, en 1981. Il a laissé de nombreux écrits posthumes, dont La colonne trajane, « une étude sur la hiéro-histoire de l’époque de la conquête romaine de la Dacie », d’après Mutti, qui l’a récemment traduite et éditée (voir La colonna traiana, All’insegna del Veltro, Parme, 1995).
► François Leclerc, Politica Hermetica, n°10, 1996.
◘ Les frères Cioran et le passé “gardiste”
Quand il voulait susciter le scepticisme des Parisiens, Emil Cioran [ici à droite aux côtés de Codreanu] se plaisait à dire que l’une des plus belles villes du monde était Sibiu/Hermannstadt. Et il pensait que Paris était devenue un “garage apocalyptique”. De Sibiu, il disait à ses interlocuteurs étonnés : « C’est une ville vraiment extraordinaire ». Il aimait évoquer le temps où il habitait cette cité transylvanienne, proche de la frontière qui séparait l’empire des Habsbourg du Royaume balkanique de Roumanie : « Il y avait là-bas trois nationalités (l’allemande, la hongroise et la roumaine) qui vivaient en parfaite convivialité. Cet fait m’a marqué pour toute ma vie, car, depuis, je ne parviens pas à vivre dans une ville où l’on ne parle qu’une seule langue, car je m’y ennuie tout de suite ».
C’est à l’âge de 10 ans qu’Emil Cioran arrive à Sibiu/Hermannstadt, après avoir pleuré pendant tout le trajet parce que son père, le Pope orthodoxe Emilian [ci-contre], l’avait arraché au paradis de son enfance, afin qu’il puisse poursuivre des études. Ce paradis, c’était le village de Rasinari. Mais l’écrivain dira plus tard : « Après Rasinari, Sibiu est la ville que j’ai aimée le plus ».
Le puiné du Pope Emilian Cioran, Aurel, aujourd’hui octogénaire, habite encore à Sibiu. C’est un avocat à la retraite. Mais s’il n’avait pas pu devenir avocat, il serait devenu moine ; ce fut son frère Emil qui l’en dissuada. Un soir, après le repas, Emil l’invita à une promenade dans les bois qui s’étendaient au-delà de la ville de Sibiu et jusqu’à 6 heures du matin, à force d’arguments de tous genres, il démontra à Aurel qu’il fallait qu’il renonce à cette idée de se faire moine. Plusieurs années plus tard, Emil regretta d’avoir eu cette importante conversation avec Aurel ; il confessa qu’en cette circonstance toute l’impureté de son âme s’était manifestée et que son acharnement n’était que le seul fruit de son orgueil. Il dit : « J’avais l’impression que tous ceux qui ne se soumettaient pas à mes argumentations démontraient qu’ils n’avaient rien compris ».
Donc, au lieu de se retirer dans un monastère, Aurel s’en alla étudier la jurisprudence à Bucarest, dans la même institution où Emil s’était inscrit en philosophie et lettres.
Les 2 frères se sont retrouvés ensemble sur les bancs des mêmes auditoires, où le philosophe Nae Ionescu donnait ses leçons. C’était une sorte de Socrate pour les générations des années 30 et il a formé des intellectuels qui très vite acquerront une réputation mondiale, comme Mircea Eliade, Constantin Noica et Emil Cioran.
Ce dernier, m’a raconté son frère Aurel, se rendait régulièrement aux cours de Nae Ionescu, même après avoir terminé ses études universitaires. Un jour, alors que la leçon était finie, le professeur a demandé aux étudiants : « Voulez-vous que je vous parle encore de quelque chose ? ». Emil s’est levé et a demandé : « Parlez-nous de l’ennui ». Alors Nae Ionescu a appronfondi la thématique de l’ennui pendant 2 heures. Une autre fois, le Professeur Ionescu a demandé à E. Cioran de lui suggérer un thème à développer au cours de sa leçon ; Cioran l’invita à parler des anges. Dans une faculté dominée par le rationalisme, seul Nae Ionescu pouvait se permettre de traiter de thèmes spirituels, parce que, comme l’a défini Eliade, il était “un logicien terrible”.
Immédiatement après la guerre, Aurel Cioran fut reconnu coupable d’avoir milité au sein du “Mouvement Légionnaire” et condamné à 7 années de prison ; sa sœur Gica reçut une peine analogue. Contrairement à Emil, qui s’est dissocié publiquement dans les années 60 de son propre passé de sympathisant de la Garde de Fer, Aurel revendique avec fierté l’option militante de sa jeunesse. Il a rencontré le “Capitaine” Codreanu dans des camps de travail légionnaires, où les jeunes réalisaient des travaux d’utilité publique négligés par le gouvernement.
Emil Cioran lui aussi fut fasciné par la figure de Codreanu ; pour la Noël 1940, il écrivit un “profil intérieur” * du Capitaine, dont on donna lecture à la radio à l’époque du gouvernement national-légionnaire. Dans ce texte, Cioran disait : « Avant Corneliu Codreanu, la Roumanie était un Sahara peuplé… Il a voulu introduire l’absolu dans la respiration quotidienne de la Roumanie… Sur notre pays, un frisson nouveau est passé… La foi d’un homme a donné vie à un monde qui peut laisser loin derrière lui les tragédies antiques de Shakespeare… À l’exception de Jésus, aucun autre mort ne continue à être présent parmi les vivants… D’ici peu, ce pays sera guidé par un mort, me disait un ami sur les rives de la Seine. Ce Mort a répandu un parfum d’éternité sur notre petite misère humaine et a transporté le ciel juste au-dessus de la Roumanie ». Par ailleurs, quelques années auparavant, E. Cioran avait écrit que “sans le fascisme l’Italie serait un pays en faillite” ; ou encore : “dans le monde d’aujourd’hui, il n’existe pas d’homme politique qui m’inspire une sympathie et une admiration plus grande que Hitler”.
On peut penser que les prises de position du Cioran de ces années-là, en dépit de ses abjurations ultérieures, seront tôt ou tard utilisée pour démoniser son œuvre, pour lui faire en quelque sorte un procès posthume, semblable à celui que l’on a intenté contre Mircea Eliade. Quand j’évoquai cette éventualité, Aurel Cioran a perdu pendant un instant son calme olympien pour manifester une grande indignation et stigmatiser la mafia qui se livrait à de telles profanations. Au cours de ces derniers mois, a-t-il ajouté, une campagne de diffamation s’est déroulée en Roumanie contre la mémoire de Nae Ionescu, précisément parce qu’il fut le maître de toute cette jeune génération intellectuelle qui sympathisait avec le “Mouvement Légionnaire”.
De fait, à peine sorti de la maison d’Aurel Cioran, j’ai trouvé sur une échope 3 éditions récentes de Nae Ionescu : un recueil de conférences tenues par le professeur en 1938 dans le pénitentier où il était enfermé avec toute l’élite du “Mouvement Légionnaire”. Parmi les internés, il y avait aussi Mircea Eliade. Emil Cioran était en France depuis un an.
► Claudio Mutti (article paru dans le quotidien indépendant L’umanità, 22 fév. 1996 ; tr. fr. : RS).
* Note en sus : Texte paru en français, sous la signature “Légionnaire à Paris”, comme préface à l’ouvrage de Paul Guiraud, Codreanu et la Garde de Fer. Cf. Cahier de l’Herne consacré à Cioran, 2009.
***
intermède philosophique
• Petits peuples : sans Histoire ou sans Destin ?
« L’évolution anormale de la Russie et de l’Espagne les a donc amenées à s’interroger sur leur propre destin. Mais ce sont deux grandes nations, malgré leurs lacunes et leurs accidents de croissance. Combien le problème national est plus tragique pour les petits peuples ! Point d’irruption subite chez eux, ni de décadence lente. Sans appui dans l’avenir ni dans le passé, ils s’appesantissent sur soi : une longue méditation stérile en résulte. Leur évolution ne saurait être anormale, car ils n’évoluent pas. Que leur reste-t-il ? La résignation à eux-mêmes, puisque, hors d’eux, il y a toute l’Histoire, dont précisément ils sont exclus.
Leur nationalisme, qu’on prend pour de la farce, est plutôt un masque, grâce auquel ils essaient de cacher leur propre drame, et d’oublier, dans une fureur de revendications, leur inaptitude à s’insérer dans les événements : mensonges douleureux, réaction exaspérée en face du mépris qu’ils craignent de mériter, manière d’escamoter l’obsession secrète de soi. En termes plus simples : un peuple qui est un tourment pour lui-même est un peuple malade. Mais alors que l’Espagne souffre pour être sortie de l’Histoire, et la Russie pour vouloir à toute force s’y établir, les petits peuples, eux, se débattent pour n’avoir aucune de ces raisons de désespérer ou de s’impatienter. Affectés d’une tare originelle, ils n’y peuvent remédier par la déception, ni par le rêve. Aussi n’ont-ils d’autres ressources que d’être hantés par eux-mêmes. Hantise qui n’est pas dépourvue de beauté, puisqu’elle ne les mène à rien et n’intéresse personne. »
♦ Cioran, « Petite théorie du destin » in La Tentation d’exister.
***
◘ Entretien avec Aurel Cioran
• Q. : Dans la nouvelle nomenclature des rues de Bucarest, on trouve aujourd’hui le nom de Mircea Eliade, mais à Sibiu, il n’y a pas encore de rue portant le nom d’Emil Cioran. Que représente Cioran pour ses concitoyens de Sibiu à l’heure actuelle ?
AC : Donner un nom à une rue ou à une place dépend des autorités municipales. Normalement, il faut qu’un peu de temps passe après la mort d’une personnalité pour que son nom entre dans la toponymie. Quant à ce qui concerne les habitants de Sibiu et en particulier les intellectuels locaux, ils ne seront pas en mesure de donner une réponse précise à votre question.
• Q. : Je vais vous la formuler autrement. Dans une ville où il y a une faculté de théologie, comment est accueilli un penseur aussi négativiste (du moins en apparence…) que votre frère ?
AC : Vous avez bien fait d’ajouter “en apparence”. Dans un passage où il parle de lui-même à la troisième personne et qui a été publié pour la première fois dans les Œuvres complètes de Gallimard, mon frère parle très exactement du “paradoxe d’une pensée en apparence négative”. Il écrit : “Nous sommes en présence d’une œuvre à la fois religieuse et antireligieuse où s’exprime une sensibilité mystique”. En effet, je considère qu’il est tout-à-fait absurde de coller l’étiquette d'”athée” sur le dos de mon frère, comme on l’a fait depuis tant d’années. Mon frère parle de Dieu sur chacune des pages qu’il a écrites, avec les accents d’un véritable mystique original. C’est justement sur ce thème que je suis intervenu lors d’un symposium qui a eu lieu ici à Sibiu. Je vais vous citer un autre passage qui remonte à 1990 et qui a été publié en roumain dans la revue Agorà : “Personnellement, je crois que la religion va beaucoup plus en profondeur que toute autre forme de réflexion émanant de l’esprit humain et que la vraie vision de la vie est la vision religieuse. L’homme qui n’est pas passé par le filtre de la religion et qui n’a jamais connu la tentation religieuse est un homme vide. Pour moi, l’histoire universelle équivaut au déploiement du péché originel et c’est de ce côté-là que je me sens le plus proche de la religion”.
• Q. : Parlons un peu des rapports entre Emil Cioran et les lieux de son enfance et de sa jeunesse. Vous demandait-il de lui parler de Rasinari et de Sibiu ?
AC : Il se souvenait de choses que moi j’avais complètement oubliées. Un jour, il m’a dit au téléphone : “Je vois chaque pierre des rues de Rasinari”. Pendant toute sa vie, il a conservé en son for intérieur les images avec lesquelles il a quitté la Roumanie.
• Q. : Il n’a jamais manifesté le désir de revenir ?
AC : Quand nous nous sommes séparés en 1937, il m’a dit, en avalant sa salive, dans le train : “Qui sait quand nous nous reverrons”. Et nous ne nous sommes revus que 40 ans plus tard, mais pas dans notre pays. Il a toujours désiré revenir. En 1991, il a été sur le point de s’embarquer pour la Roumanie. C’est alors que la maladie l’a frappé, qu’il a dû rentrer à l’hôpital. Dans ces derniers moments, il a été contraint d’utiliser une chaise roulante. Il craignait forcément de voir une réalité toute autre, s’il était revenu. Et effectivement il y a eu beaucoup de changements ; à Rasinari, la composition sociale a complètement changé : quasi la moitié des habitants du village travaillent à la ville, ce qui conduit forcément à un changement de mentalité. Tout est bien différent du temps où nous étions adolescents. À Rasinari, nous étions des gamins de rue, nous allions en vadrouille toute la journée à travers champs, forêts et rivières…
• Q. : … et à Coasta Boacii.
AC : Oui, en effet, il évoquait sans cesse, avec énormément de regrets, ce paradis qu’était Coasta Boacii. “À quoi bon avoir quitté Coasta Boacii ?”, disait-il. Ensuite, il y avait ce pacage, près de Paltinis, où nous nous rendions tous les étés. Nous y restions un mois, dans une baraque tellement primitive, située dans une clairière où régnait une atmosphère extraordinaire.
• Q. : Vous avez été très proche de votre frère non seulement dans les années d’enfance mais aussi pendant votre adolescence et votre jeunesse. Parlez-moi de vos expériences communes…
AC : Nous assistions aux cours de Nae Ionescu à l’Université. Ce professeur était une figure extraordinaire ! Beaucoup de gens venaient l’écouter et pas seulement des étudiants. Mon frère y retournait même après avoir quitté l’université, pour rendre visite au professeur. Un jour, dès que la leçon fut terminée, Nae Ionescu a demandé : “De quelles choses devrais-je encore parler ?”. Et mon frère, spontanément lui a répondu : “De l’ennui”. Alors Nae Ionescu a prononcé 2 leçons sur l’ennui. Par la suite, ses adversaires ne sachant plus quelles armes utiliser pour l’attaquer, parce qu’il était le maître à penser de toute la jeune génération d’intellectuels qui soutenaient le “Mouvement Légionnaire”, ils l’ont accusé d’être… un plagiaire ! Ce genre d’attaques est une manifestation infernale… L’œuvre d’une mafia de criminels, qui a commencé par s’attaquer à Heidegger, puis à chercher à faire le procès d’Eliade…
• Q. : … et même de Dumézil !
AC : Toujours sous prétexte d’antisémitisme. En Roumanie, à l’époque, il y avait bien sûr de l’antisémitisme, en réaction à l’arrivée massive d’un million de juifs venus de Galicie. En ce temps-là, c’était un véritable problème. Mais j’ai l’impression que cette manœuvre visant à criminaliser Eliade, Noica [ci-contre jeune] et les autres intellectuels de la “jeune génération” produira des effets contraires à ceux désirés.
• Q. : Vous avez milité dans le Mouvement Légionnaire. Avez-vous connu Corneliu Codreanu ?
AC : C’était un homme exceptionnel à tous points de vue. Il avait du charisme. J’ai souvent dit qu’il était un trop grand homme pour le peuple roumain, trop sérieux, trop grave. Il voulait une réforme radicale, basée sur la religion. Il était un esprit très intensément religieux. Il y a encore une chose qui m’impressionne profondément aujourd’hui : la manière dont le Mouvement Légionnaire abordait les problèmes économiques. Le Mouvement avait ouvert des restaurants, des réfectoires, où l’on vous servait un très bon repas, avec du vin en quantité limitée. L’idée qui me paraissait extraordinaire, c’est que les prix n’étaient pas fixés. Chacun payait selon ses propres moyens ou selon son bon plaisir.
• Q. : Où avez-vous connu le Capitaine ?
AC : À Bucarest, parce que j’y étudiait la jurisprudence. Mais je l’ai rencontré 2 ou 3 fois dans un camp de travail légionnaire. C’était un homme exceptionnel à tous points de vue.
► Propos recueillis à Sibiu le 3 août 1995 par Claudio Mutti et parus dans la revue Origini n°13 (fév. 1996).
— Regards croisés —
Légionnarisme ascétique
BUCAREST, mars 1938
Rapidement notre auto laisse derrière elle cette chose curieuse qu’est le centre-ville de Bucarest : un ensemble de petits buildings et d’édifices ultra-modernes, principalement de type “fonctionnaliste”, avec des devantures et des magasins au style oscillant entre parisien et americain, le seul élément exotique étant les fréquents chapeaux d’astrakan des notables et bourgeois. Nous atteignons la gare du Nord, nous prenons une poussiéreuse route provinciale longée de petits édifices du genre de ceux de l’ancienne Vienne, qui mène en droite ligne à la campagne. Après une bonne demi-heure, la voiture tourne brusquement à gauche, prend un chemin de campagne, s’arrête face à un édifice presqu’isolé parmi les champs : c’est la dite “Maison Verte”, résidence du Chef des “Gardes de Fer” roumains.
“Nous l’avons construite de nos propres mains”, nous disent avec un certain orgueil les légionnaires qui nous accompagnent. Intellectuels et artisans se sont associés pour bâtir la résidence de leur chef, ce qui a pour eux presque la portée d’un symbole et d’un rite. Le style de la construction est roumain : des 2 côtes, elle se prolonge par une espèce de portique, ce qui n’est pas sans pratiquement donner l’impression d’un cloître.
Nous entrons puis montons au premier étage. Vient à notre rencontre un homme jeune, grand et élancé, en tenue sportive, avec un visage ouvert inspirant immédiatement noblesse, force et loyauté. C’est justement Corneliu Codreanu, chef de la Garde de Fer. Son type est caractéristique de l’aryo-romain : on dirait une réapparition de l’antique monde aryo-italique. Alors que ses yeux gris-bleus expriment la dureté et la froide volonté propres aux Chefs, se dégage en même temps, dans l’ensemble de l’expression, une touche singulière mêlant à la fois idéalité, intériorité, force d’âme et compréhension humaine. Même sa façon de converser est spécifique : avant de répondre, il semble s’absorber en lui-même, se retirer, puis, tout à coup, commence à parler, s’exprimant avec une précision quasi géométrique en phrases bien articulées tout en tenant un discours organique.
« Après toute une clique de journalistes, de toutes nations et bords, ne sachant rien faire d’autre que de me questionner sur ce qui a trait à la politique la plus contingente, c’est bien la première fois, et je le note avec satisfaction – remarque Codreanu –, que vient chez moi quelqu’un qui s’intéresse, avant tout, à l’âme, au noyau spirituel de mon mouvement. J’avais au demeurant trouvé une formule pour contenter ces journalistes et leur dire un peu plus que rien, à savoir : nationalisme constructif.
L’Homme se compose d’un organisme, c’est-à-dire d’une forme organisée, puis de forces vitales, enfin d’une âme. On peut en dire de même pour un peuple. Et la construction nationale d’un État, bien qu’elle reprenne naturellement ces trois éléments, peut néanmoins surtout subir, et ce pour des raisons de détermination variable et d’hérédité différente, les impulsions en particulier de l’un d’entre eux.
Selon moi, ce qui prédomine dans le mouvement fasciste, c’est l’élément État, qui correspond à celui de la forme organisée. On retrouve là la trace de la puissance organisatrice de la Rome antique, détentrice du droit et des institutions politiques, dont l’Italien est le plus pur hériter. Dans le national-socialisme par contre, l’accent est surtout mis sur ce qui se rapporte aux forces vitales : la race, l’instinct racial, l’élément ethnico-national. Concernant le mouvement légionnaire roumain, ce qui prend une signification centrale a trait à ce qui, dans un organisme, correspond à l’élément âme : autrement dit à l’aspect spirituel et religieux.
C’est de là que vient ce qui fait le signe distinctif des différents mouvements nationaux, pour autant qu’en fin de compte ils réunissent ces trois éléments et n’en négligent aucun. Le caractère spécifique de notre mouvement prend sa source dans un lointain héritage. Hérodote déjà appelait nos pères : ‘Les Daces Immortels’. Nos ancêtres géto-thraces avaient foi, avant même le christianisme, en l’immortalité et l’indestrucibilité de l’âme, ce qui témoigne de leur disposition intérieure à la spiritualité. La colonisation romaine a ajouté à cet élément l’esprit romain organisateur et donneur de formes. Certes les siècles postérieurs ont vu notre peuple se disloquer et tomber dans la misère, mais de même qu’avec un cheval malade et fruste nous pouvons déceler une noblesse du maintien, nous reconnaissons, dans le peuple roumain d’hier et d’aujourd’hui, les éléments latents de ce double héritage.
Et c’est cet héritage – continue Codreanu – que le mouvement légionnaire cherche à réveiller. Il prend appui sur l’esprit vivifié avec la volonté de faire advenir un homme spirituellement nouveau. Une fois cette tâche remplie en tant que ‘mouvement’, nous reste celle du réveil du second héritage, autrement dit de la force romaine organisatrice politiquement. En effet, si pour nous l’esprit et la religion sont le point de départ, le ‘nationalisme constructif’ en constitue le point d’arrivée, presque une conséquence. L’éthique indissociablement ascétique et héroïque de la “Garde de Fer” se donne pour tâche de faire rejoindre un point à l’autre. »
Nous demandons alors à Codreanu quel rapport entretient la spiritualité de son mouvement avec la religion chrétienne orthodoxe. Voici sa réponse :
« De manière générale, nous tendons à exalter à travers une conscience nationale et une expérience vécue ce qui trop souvent, dans cette religion, s’est momifié jusqu’à devenir le traditionalisme d’un clergé somnolent. Qui plus est, nous nous trouvons dans une situation propice du fait que notre religion, structurée nationalement, ne connaisse aucun dualisme entre foi et politique et puisse ainsi nous fournir des éléments éthiques et spirituels sans s’imposer comme une entité en quelque façon politique. Et puis, de notre religion, le mouvement des Gardes de Fer reprend une idée fondamentale : celle de l’œcuménicité. Celle-ci est le dépassement positif de tout internationalisme ou universalisme abstrait et rationaliste. L’idéal œcuménique renvoie en effet à une societas comme unité de vie, comme organisme vivant, comme un vivre-ensemble non seulement avec notre peuple, mais aussi avec nos morts et avec Dieu.
L’accomplissement d’un tel idéal sous la forme d’une expérience effective est au cœur de notre mouvement ; politique, parti, culture, etc., ne sont pour nous que suites logiques et variations. Nous nous devons de revivifier cette réalité centrale, tracant ainsi une voie pour rénover l’homme roumain, pour ensuite œuvrer politiquement et contribuer à bâtir nation et État. C’est pour nous un point important, nullement théorique mais bel et bien pratique, que cette présence des morts au sein de la nation œcumenénique : de nos morts et par-dessus tout de nos héros. Nous ne pouvons nous détacher d’eux ; comme des forces devenues libres de la condition humaine, ils imprègnent notre vie la plus haute et lui portent soutien. Lorsque les légionnaires se réunissent périodiquement par petits groupes, appelés ‘nids’ [cuib], ces rassemblements suivent des rites spéciaux et celui par lequel s’ouvre chaque réunion est l’appel à tous nos camarades tombés, auquel les participants répondent par ‘Présent !’. Ceci ne signifie pourtant pas pour nous simple cérémonial ou allégorisation, mais bien plus évocation réelle.
Nous distinguons — poursuit Codreanu — individu, nation et spiritualité supérieure, et considérons dans le dévouement héroïque ce qui mène de l’un à l’autre de ces éléments jusqu’à tendre vers une unité supérieure. Nous nions sous toutes ses formes le principe bassement utilitaire et matérialiste : non seulement sur le plan de l’être singulier, mais aussi sur celui de la nation. Au-delà de la nation, nous reconnaissons des principes éternels et intangibles, au nom desquels nous devons être prêts à combattre, à mourir même et à tout subordonner, avec au moins autant de résolution qu’au nom de notre droit de vivre et de défendre notre vie. La vérité et l’honneur sont, par ex., des principes métaphysiques, que nous mettons plus haut que notre nation elle-même. »
Nous avons appris que le caractère ascétique du mouvement des Gardes de Fer ne relève pas que d’une généralité, mais également d’une concrétude, ou, pour le dire autrement, d’une pratique. Par exemple, est imposée la règle du jeûne : 3 jours par semaine, 800.000 hommes environ pratiquent le dénommé “jeûne noir”, c’est-à-dire l’abstinence de toute sorte de nourriture, boisson et tabac. De même, la prière tient une place importante dans le mouvement. En outre, pour le Corps d’Assaut spécial qui porte le nom de 2 chefs légionnaires tombés en Espagne, Mota et Marin, la règle du célibat s’appplique. Nous demandons à Codreanu qu’il nous précise le sens de tout cela. Il semble se concentrer un moment, puis répond :
« Nous ne pouvons éclaircir ces deux aspects qu’en les renvoyant tous deux au dualisme de l’être humain. Ce dernier est en effet composé d’un élément matériel d’ordre naturel et d’un élément spirituel. Quand le premier domine le second, c’est “l’enfer”. Tout équilibre entre les deux se montre de fait fragile et contingent. Et seule la domination absolue de l’esprit sur le corps manifeste la condition normale et la base de toute force pleinement agissante, de tout héroïsme véritable. Le jeûne est donc pratiquée par nous en ce qu’il favorise une telle condition, déserrant ainsi les liens corporels et permettant par là l’autolibération et l’auto-affirmation de la volonté pure.
Alors, à tout cela, nous joignons la prière, nous demandons que les forces d’en haut s’unissent aux nôtres et nous soutiennent invisiblement. C’est ce qui nous amène au second aspect : c’est une superstition que de penser que dans chaque combat seules les forces matérielles et simplement humaines sont décisives ; entrent également en jeu, bien au contraire, les forces invisibles, spirituelles, tout au moins aussi efficaces que les premières.
Nous sommes conscients de la positivité et de l’importance de telles forces. C’est pour ces raisons que nous assignons au mouvement légionnaire un caractère ascétique marqué. Dans les anciens ordres de chevalerie, le principe de chasteté avait également cours. Je tiens néanmoins à remarquer que chez nous celui-ci est restreint au seul Corps d’Assaut, car d’un point de vue pratique, il est plus recommandé de ne pas avoir d’empêchements familiaux pour celui qui doit se vouer entièrement à la lutte, sans craindre la mort. Au demeurant, on ne peut faire partie de ce corps que jusqu’à 30 ans achevés.
Mais, dans tous les tout cas, il reste toujours une position de principe : il y a d’un côté ceux qui ne connaissent que la “vie” et ne recherchent par conséquent que prosperité, richesse, bien-être et opulence ; de l’autre, il y a ceux qui aspirent à quelque chose de plus que la vie, à la gloire et à la victoire dans une lutte tant intérieure qu’extérieure. Les Gardes de Fer prennent rang parmi cette seconde sorte d’êtres. Et leur ascétisme guerrier se complète par une dernière règle : que ce soit par le vœu de pauvreté auquel est tenue l’élite des chefs du mouvement ou bien par des préceptes de renoncement au luxe, aux divertissements creux, aux passe-temps dits mondains, c’est bien à la finale une invite à un véritable changement de vie que nous faisons à chaque légionnaire. »
► Julius Evola (première publication : Il Regime Fascita, 22.3.1938 ; tr. fr. [légèrement remaniée] : P. Baillet, Totalité n°2, 1977).
***
◘ Lecture critique :
Ce n’est finalement ni en Italie ni en Allemagne mais en Roumanie qu’Evola verra à l’œuvre ce qu’il tiendra toujours pour le seul mouvement authentiquement Traditionnel parmi ceux se réclamant d’idées anti-démocratiques, à savoir la Garde de Fer de Corneliu Zelea Codreanu.
c) La Garde de Fer, seul mouvement authentiquement Traditionnel ?
Evola ne tarit pas d’éloges sur Codreanu, rencontré lors d’un voyage à Bucarest en 1938, dans lequel il voit : « l’archétype même aryo-romain ». Le chef de la Garde de Fer apparaît à notre auteur comme « une des figures les plus dignes et les mieux orientées spirituellement [qu’il ait] rencontrées dans les mouvements nationaux de l’époque » (Le chemin du cinabre). Les 2 hommes s’étaient en effet immédiatement découvert, toujours à en croire Evola, une « quasi-totale communion d’idées ». Quant au légionnarisme roumain, déjà louable par sa dimension ascétique reposant sur des « prémisses authentiquement spirituelles », il conviendrait de voir en lui « l’une des idéologies parmi les plus dignes d’intérêt en Europe, [qui] nous montre la possibilité d’aller au-delà de certaines barrières, que d’aucuns considèrent comme infranchissables : dans cette idéologie, la référence à la conception œcuménique de l’Église orthodoxe donne lieu à un idéal organique de vie nationale, en tant qu’unité de race et de foi, des vivants, des morts et de la loi de Dieu – idéal qui, sous certains aspects et selon la même direction, va au-delà de ce à quoi les idéologies de l’Axe n’ont pas encore atteint, en raison de circonstances d’ordre contingent (idéologies considérées, bien entendu, sous leur aspect spirituel, et non politique) ».
Le jugement peut laisser perplexe, même si les points de rapprochement entre la vision du monde évolienne et celle de ce « faux fascisme » que constitua le mouvement de Corneliu Zelea Codreanu sont loin d’être négligeables. Éloge de la voie héroïque, hostilité au communisme, à l’« esprit juif » pensé comme paradigme du monde moderne, croyance en une « troisième dimension de l’histoire », se retrouvent en effet aussi bien dans l’une que dans l’autre. Mais les divergences, pour être sans doute moins apparentes, n’en sont guère moindres.
En premier lieu, force est de constater que, si la Garde de Fer se voulut certes un mouvement spirituel, elle fut avant tout un mouvement chrétien. Corneliu Zelea Codreanu fonde ainsi toute son action sur : « la croyance en Dieu », et écrit, durant sa réclusion à la prison de Jilava : « Nous allons ressusciter au nom du Christ et uniquement par le Christ, parce qu’en dehors de la foi dans le Christ, personne ne ressuscitera et ne sera sauvé ». Or, nous avons vu que J. Evola attribue au christianisme une très lourde responsabilité dans le processus décadentiel qui a, selon lui, conduit à l’instauration du monde moderne, allant jusqu’à le considérer comme un instrument de la dévirilisation spirituelle. Que l’inspiration chrétienne de cet « envoyé de l’Archange » que se voulait Codreanu et de son mouvement renvoie, non au catholicisme, mais à l’Église Orthodoxe, n’aurait, en toute logique, pas dû faire grande différence pour notre auteur. Ensuite, ce christianisme présente un caractère éminemment mystique, Codreanu évoquant de manière explicite : « la mystique chrétienne » à laquelle il donne pour finalité : « l’extase ». Il s’agit ici d’une circonstance aggravante selon les critères évoliens, puisque, on s’en souvient, le métaphysicien italien place toute attitude mystique sous le signe du « pôle féminin de l’esprit », ce qui le conduit à « tracer une frontière entre mystique et initiation », la seconde seule lui paraissant renvoyer au « pôle masculin » de ce même esprit. Evola aurait donc dit être conduit, toujours en toute logique relativement à ses propres postulats, à ranger la Garde de Fer au nombre des mouvements s’inspirant bien davantage de la « spiritualité lunaire » (féminine) que de la « spiritualité solaire » (virile).
Un dernier point à considérer est celui de faction politique de la Garde de Fer. Il n’est guère possible de douter du fait que Codreanu ait été tout autant hostile aux valeurs démocratiques qu’Evola lui-même. Mais cette pétition de principe n’empêcha pas celui que ses partisans appelaient avec déférence “le Capitaine” de recourir à plusieurs reprises aux élections pour faire triompher ses idées, même si le légionnarisme roumain s’opposait au “machiavélisme” que ses membres tenaient pour inhérent au jeu électoral. C’est là une attitude dont on aurait pu s’attendre à ce qu’elle provoque les critiques du métaphysicien italien. La dimension Traditionnelle (au sens évolien du terme) de la Garde de Fer parait donc être, en définitive, pour le moins problématique, et l’on distingue finalement assez mal, la sympathie d’Evola pour Codreanu mise à part, pourquoi le mouvement roumain a retenu l’attention de l’auteur italien davantage que d’autres, la Phalange espagnole par ex.
La fin de la Seconde Guerre mondiale marque, en même temps que l’effondrement des forces de l’Axe, celui du rêve évolien d’une restauration Traditionnelle en Europe. Désormais convaincu de l’impossibilité de voir apparaître une « civilisation des héros » contemporaine, le métaphysicien italien va s’attacher à définir de nouvelles « orientations », afin de fournir une base doctrinale éprouvée, particulièrement destinée : « aux groupes qui, en Italie, n’ont pas tout oublié, qui résistent et réagissent encore dans une certaine mesure » (L’Arc et la massue).
► Jean-Paul Lippi, Julius Evola, métaphysicien et penseur politique, Âge d’Homme, 1998, p. 227-228.